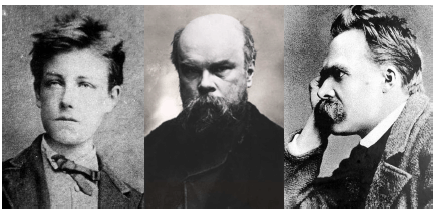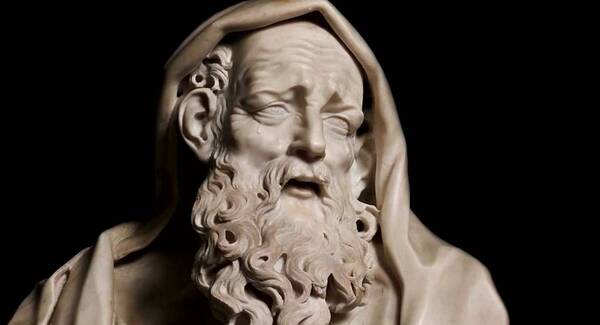Essai sur le mouvement en littérature 4/5 : Retour sur Verlaine, ouverture vers la musique
Publié par Xavier Hiron, le 10 avril 2021 740
Rimbaud, Verlaine, Nietzsche, trois des auteurs cités dans l’étude © wiki commons
par Xavier Hiron
(pour une meilleure appréhension de la thématique initiale, se référer si nécessaire aux articles 1/5, 2/5 et 3/5)
Il est connu - et l’on en comprend aisément le pourquoi à la lecture des articles qui ont précédé - que la sécurité, autant psychologique que matérielle, n’est pas l’état le plus propice à l’éclosion de l’œuvre d’art. Car l’artiste, on l’aura bien compris, est un être qui, par son activité créatrice, met véritablement sa vie et son esprit en jeu. Par le déséquilibre ardemment provoqué où se révèle le danger constant de la perte de ses repères communs, ce risque devient perpétuel. Il ne faut pas négliger de considérer, en effet, que l’identité de l’artiste en général, et du poète en particulier, est son principal terrain d’expérimentation. Ce qui est à même de provoquer un état de tension en continu et une mise en péril quasi permanente de sa stabilité identitaire. Ce dont se ressentent la nature même et la qualité intrinsèque de son dialogue intérieur, potentiellement porteur de richesse, mais qui peut tout aussi bien expliquer sa forte réactivité aux éléments perturbateurs qu’il ne maîtriserait pas. Car même lorsqu’il entreprend de dialoguer avec le monde extérieur, perçu en tant que double ou miroir de sa propre identité cherchant à se matérialiser, cet échange reste par essence un débat face à soi-même ; une sorte de soliloque en prise directe avec sa conscience. En ce sens, les artistes sont effectivement des écorchés vifs. Et pour ceux dont le processus est poussé à son comble, potentiellement des écartelés, voire des « crucifiés ». Mais ces sortes de suppliciés sont en réalité et pour une large part leur propre bourreau… Comme l’évoque cet extrait de poème, lui aussi ancien, intitulé Cœur de pierre :
Que n'ai-je été fouillé sous le marteau
Par mes ciseaux, des éclats jusqu'au ciel ?
Mais non, mes grains de chair.
Mais non, mes chairs de pierres :
Ô ces débris sanglants que l'on nomme matière !
Ici, moi-même suis sculpteur.
Moi-même qui me sculpte, et pourtant torturant
Une glaise luisante. Et moi-même qui frappe.
Moi-même qui me brise.
Qui éclate mes chairs, mes modelés de chairs.
Moi-même qui, du dedans et tel qu'en dehors
S’acharne avec souffrance et maltraite mes formes.
Ô souffrance - une gloire -, ô nudité des formes !
Cœur de pierre
Mais sur quoi, alors, ce travail ambivalent entre « se faire » et « se briser » devrait-il se bâtir, au juste ? Pour tenter de le décrypter, réexaminons le cas de Paul Verlaine et essayons, pour se faire, d’appréhender au plus près le fonctionnement intime du poète. En effet, nous avons vu que, spontanément, il ne va jamais beaucoup plus loin qu’une vague promenade. S’il s’agit effectivement pour lui d’une concrète « mise en mouvement », ce poète-ci ne découvre jamais que de proches jardins peuplés de grottes et de faunes, ainsi que de vagues bosquets incertains sur lesquels il projette en permanence les images qu’il s’invente autour de ses « galantes ». Si l’on veut vraiment savoir ce que Paul Verlaine pense de ces escapades au long cours que lui a imposées la fréquentation d’Arthur Rimbaud, il faut certainement se reporter à la pièce n° XX de La bonne chanson (recueil déjà cité), qui est sans ambiguïté à ce sujet. Aussi, restituons-la dans son intégralité :
J’allais par des chemins perfides,
Douloureusement incertain.
Vos chères mains furent mes guides.
Si pâle à l’horizon lointain
Luisait un faible espoir d’aurore ;
Votre regard fut le matin.
Nul bruit, sinon son pas sonore,
N’encourageait le voyageur.
Votre voix me dit : « Marche encore ! »
Mon cœur craintif, mon sombre cœur
Pleurait, seul, sur la triste voie ;
L’amour, délicieux vainqueur,
Nous a réunis dans la joie.
On est loin, véritablement bien loin du fonctionnement typique des artistes qui vivent de la profusion du mouvement. De ceux qui s’accordent de longues ballades solitaires, tel un Jean-Jacques Rousseau par exemple, ou passent leur temps à ranger, déranger, re-ranger, voire déménager (au sens de « délocaliser ») régulièrement leur(s) atelier(s), comme ce fut le cas pour Pablo Picasso - à ce sujet d’ailleurs, on ne souligne jamais assez à quel point l’activité de peintre est, pour qui la pratique intensément, éprouvante autant psychologiquement que physiquement parlant -.
Si j’en reviens ici à Paul Verlaine, c’est qu’il existe une donnée plus intellectuelle qui me paraît caractériser le mouvement chez cet auteur. Et ce mouvement est la rime elle-même. La rime est un en soi. Elle est révélatrice d’une mesure qui peut très bien « imiter », dans l’esprit de celui qui la pratique à haute dose, le rythme du marcheur. Il est possible en effet de considérer que l’entraînement physique de la marche est proche d’un entraînement plus purement intellectuel de la cadence, par le biais de la scansion, et que les deux activités, certainement, vont de paire. Ce que tendraient à prouver les deux exemples précédemment cités de Jean-Jacques Rousseau et de Pablo Picasso. Car si la marche, qui est l’expression même de la mobilité, présente l’immense avantage, ne serait-ce que par l’appréciation du glissement ou de la diversité des points de vue qu’elle engendre sur une même chose, d’ouvrir l’esprit à une activité intellectuellement intense, il est certain que l’activité intellectuelle, pour sa part, une fois initiée, joue son propre effet d’entraînement sur elle-même.
Il suffit pour s’en persuader de considérer les huit cents cinquante pièces écrites par Paul Verlaine, lui qui fut proclamé Prince des poètes par ses pairs peu avant sa disparition, à l’âge de cinquante et un ans seulement. Et le tout en rimes au moins suffisantes. Dans le même ordre d’idées, je suis frappé de voir les correspondances qu’il semble que l’on puisse tirer, sur le seul plan du fonctionnement individuel - c’est-à-dire physiologiquement parlant -, entre un tel ressassement rythmique et certaines névroses professionnelles, car le travail, tel que l’organise notre société actuelle, est à proprement parler devenu lui aussi une drogue. On le remarque aisément lorsque nous n’arrivons pas à trouver le sommeil après une journée d’activité intellectuelle intense, tandis qu’a contrario une bonne nuit de sommeil semble avoir trié pour nous nos idées confuses de la vieille.
Aussi, pour reprendre l’exemple particulier de Jean-Jacques Rousseau, si la marche paraît bien avoir joué ponctuellement un rôle apaisant sur l’individu qu’il était, tout autant que bénéfique pour sa production intellectuelle, elle ne l’empêcha pas de développer à la longue de véritables schémas pathologiques. Sont là pour le prouver les idées quelque peu loufoques - pour ne pas dire plus, aux dires mêmes de ses contemporains - dont il est frappé, comme lorsqu’il imagina une écriture en continu des portées musicales, de gauche à droite puis de droite à gauche, dans le seul but, fort louable au demeurant, de fluidifier la lecture du musicien… Sans se rendre compte sur l’instant de l’inconfort réel que pouvait générer, pour l’utilisateur moyen, son système de lecture.
Que tirer de concret, me direz-vous, de toutes ces observations ? N’est-on pas en présence de contre-exemples patents de notre esquisse de démonstration ? Et était-on en droit, de ce fait, de se poser la question d’un lien supposé entre l’activité de création et le mouvement ? Autrement dit : le mouvement physique peut-il accompagner d’une façon ou d’une autre le développement de la pensée ? Ou bien cette hypothèse, finalement, ne constitue-t-elle, elle aussi, qu’un leurre ? Dans les faits, il semble que la science actuelle veuille répondre par la négative à cette dernière d’interrogation. Examinons ses arguments.
Le phénomène de la production naturelle de l’adrénaline et de ses dérivés, telle la dopamine, nous dit celle-ci, est largement développé par l’activité physique. Ce qui explique en partie la possible affinité que cette dernière présente, chez certains individus, avec l’activité intellectuelle, et particulièrement par son rôle moteur dans la création, même si la corrélation systématique du développement de l’une et de l’autre n’est pas observée. Disons que, plus simplement, le sentiment d’épanouissement éprouvé par la pratique de l’une est très probablement susceptible, mais chez certains individus seulement, de favoriser l’éclosion de l’autre. Cependant, dans mon propre cas par exemple, si j’ai réellement commencé à courir très jeune, au moment même où je me suis confronté à mes premières pages d’écriture et si, par la suite, l’éclosion véritable de ma vocation poétique a correspondu sans conteste avec ma période de pratique intensive du sport, tout un tas d’autres facteurs existe bel et bien, et je me garderais assurément, moi qui ai commencé à écrire et courir vers ma douzième année, de décréter quelle activité - qu’il faudrait dans ce cas appeler « première » - aurait su présider à une autre, qui deviendrait de facto « seconde ».
Dans tous les cas, le fait certain est que la pratique de l’activité intellectuelle désenclave la pensée de l’individu. Raison pour laquelle les artistes exacerbés sont généralement des personnes désinhibées : caractère certes indispensable au développement d’une pensée artistique autonome et originale, mais qui contient souvent en germe, puis s’affirmant dans la durée, des risques de dérapages, voire d’un véritable déraillement de la fonction relationnelle et comportementale, dans cette partie dite sociable de l’« entité » artiste.
Est-ce pour cela que les artistes les plus extrêmes, mais qui sont aussi, le plus souvent, les plus accomplis, accaparés qu’ils sont par la poursuite de l’aboutissement de leur art, en viennent à constater que se creuse inéluctablement un décalage avec le restant de leurs congénères et qu’ils se retrouvent immanquablement, comme je l’ai exprimé dans un autre de mes poèmes anciens, « en butte aux âmes vides » ? Ceci peut expliquer certainement beaucoup de cela. Car le vide, dans le cas présent, doit être assimilé (et est effectivement perçu comme telle) à la forme la plus aboutie de l’immobilisme. Situation qui, on en conviendra, peut apparaître très vite, à certains individus dont la vivacité d’esprit est véritablement éprouvée, tel un athlète de haut niveau, comme le comble de l’insupportable.
* * *
Mais cette tendance réelle des artistes comporte en soi, on vient de le voir, des dangers éminents et, au surplus, un risque majeur. Qui est celui de voir se fissurer peu à peu l’esprit même de l’individu : que ce soit presque en douceur - ne cherchons pas plus loin le motif du retrait de la poésie d’Arthur Rimbaud, tant il s’agit clairement, augmentée de dépit, d’une démarche de protection contre soi-même (c’est-à-dire contre ce mouvement en lui qu’il a lui-même créé) - ou au contraire tout à fait brutalement, tel un séisme.
La première étape vers cet enchaînement infernal s’observe généralement par la perte initiale ou progressive des perceptions de la convenance et de la bienséance ; bref, de ces limites sociales dites « conventionnellement acceptables ». Le cas d’Amadeus Mozart - autre grand voyageur de par son activité - est de ce point de vue exemplaire. Il apparaît clairement, par le biais de sa correspondance notamment, et particulièrement dans celle qu’il entretient avec sa sœur, que le foisonnement intellectuel qui l’habite très jeune est de nature volcanique, ne lui permettant qu’à très grand’ peine de situer les règles même de sa pensée à l’intérieur des contours convenus du langage. Le langage est pour lui matière à un jeu cosmique de sons et de pensées, lesquelles viennent incessamment s’entrechoquer en lui, se désarticuler, se démantibuler puis se recombiner, le tout pour le bien d’une « pétillance » d’être, mais qui semble parfois se dérober à tout entendement. Le jeu est poussé à l’extrême, et si la musique de Mozart n’avait elle-même été que cela, elle en aurait certainement perdu en force, profondeur et puissance. Ce qui habite Mozart, je veux dire existentiellement parlant, a pris délibérément comme demeure exclusive, comme unique domaine d’élection, le support de la musique. Là encore, la forme « élue », c’est-à-dire inconsciemment choisie par l’entité artiste - et c’est en cela que le lien qui se noue alors est d’autant plus fort -, paraît avoir primé.
Mozart enfant peint par Greuze en 1763-64 © wiki commons
Ainsi, le mouvement symboliserait le déplacement même de la pensée. Il figurerait la délocalisation de son point d’ancrage central et naturel - la raison « identitaire » de notre propre individualité -, mobilité qui porterait en soi le germe d’une remise en cause intellectuelle, morale et sensible de la vision même du monde telle que la porte en lui l’artiste. Ce qui nous frappe ici, notamment avec le cas exceptionnel d’Amadeus Mozart, c’est que cette mobilité extrême semble être conceptuellement liée à son individu, et ceci depuis son plus jeune âge.
Si d’aventure nous étions amenés à pousser cette constatation jusqu’à son point ultime, nous en viendrions certainement à nous poser la question du rôle même de la raison dans la démarche artistique. Ou plus exactement, de sa véritable part dans le fonctionnement créatif de certains individus. Car en effet, on entrevoit confusément que le mouvement premier de la pensée de l’artiste est plus souvent intuitif que raisonné. Mais la raison, le rationalisme n’en sont pas pour autant exclus. Sur ce point, Henry Le Chénier rappelle - il n’a assurément pas créé la formule - qu’il y a des œuvres qu’on aime avec le cœur et d’autres avec la raison. Cependant, il va sans dire que, la maturité du cheminement artistique aidant, les œuvres les plus riches qui nous sont données de ressentir sont indubitablement celles qu’on aime à la fois avec le cœur et avec la raison. Comme cela est le cas pour ce tour de force sublime qu’est le Requiem de Mozart, par exemple. Ou avec ces concertos unanimement encensés, au point d’être devenus les prototypes de leur genre, que sont les Quatre saisons d’Antonio Vivaldi : autant pour leur forme que pour l’acceptation implicite de la marche vitale du temps. Resterait seulement à déterminer l’ordre d’apparition respective de ce cœur et de cette raison sur l’échiquier de notre perception… ? Mais ceci est une autre histoire.
(lire la fin de cet essai dans mon article 5/5 à venir)
* * *