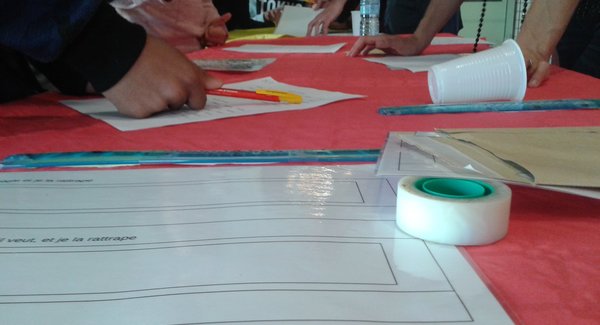La communication scientifique est-elle entâchée d'impérialisme culturel ?
Publié par Pierre Albigès, le 17 novembre 2018 3.2k
Ces dernières décennies, le mot « public » est devenu pluriel pour tenter de représenter l'hétérogénéité des personnes qui peuvent être touchées par la communication scientifique et technique (CST). Mais cette pluralité des publics ne vient pas seule. Elle est accompagnée d'une pluralité de besoins, de savoirs et de pratiques.
Le choix des publics
Prendre conscience de cette pluralité révèle qu'une pratique de communication scientifique ne peut toucher l'ensemble de la population. Certains ne la percevront pas ou ne pourront pas y accéder. Chaque pratique crée de facto des exclusions.
Pourtant l'inclusion de tous dans la communication scientifique est perçue comme bénéfique tant sur les plans personnels que sociétaux, car les connaissances qu'elles permettent de transmettre sont perçues comme telles. Dans cette vision de démocratisation de la culture, devenir savant permet de grandir en tant qu'individu, de devenir un citoyen complet et d'être en pleine mesure de prendre des décisions économiques et politiques éclairées. L'exclusion est donc perçue comme problématique.
C’est dans le manifeste de Villeurbanne, en 1968 que la notion de non-public semble apparaître pour la première fois, suivie d’une définition : « immensité humaine composée de tous ceux qui n’ont pas encore accès, ni aucune chance d’accéder prochainement au phénomène culturel. [...] les non-cultivés qui n’ont ni les moyens, ni l’instruction pour accéder à la culture. [...] [ceux] qui dénoncent un système social et refusent leur intégration culturelle. »
Des études observant les non-publics ressortent que l’on est plus susceptible d’assister à des activités de communication scientifique si l’on fait partie d’une catégorie socio-économique spécifique : famille blanche de classe moyenne et vivant en milieu urbain. Autrement dit, les activités de communication scientifique sont bien plus pratiquées par les classes sociales dominantes, et le sont moins par les personnes provenant de milieux ethniques, sociaux et économiques désavantagés.
Perception et réalité
Les non-publics sont parfois perçus de la part des acteurs de la CST comme déficients et en partie responsables de leur propre exclusion. Ils sont alors jugés comme possédant les mauvaises valeurs et les mauvaises attitudes, voir comme exprimant un manque d’appréciation des savoirs.
Ces non-publics sont pourtant consommateurs de sciences. Leur consommation prend la forme de pratiques populaires et accessibles : programmes télévisuels, contenus web. Différence majeure avec les pratiques dont ils semblent exclus : ces pratiques utilisent des supports implantés dans leur quotidien. Seulement dans ces pratiques, cette consommation des sciences vient se superposer à leur consommation culturelle habituelle et n’est pas ce qu’ils y cherchent en priorité.
Cette vision condamnante des non-publics, qui sont jugés par les institutions publiques de « publics empêchés » écarte l’influence des inégalités structurelles et tombe dans une vision passive et dichotomiques des publics, avec d’un côté les participants et de l’autre les « empêchés ». Les études des non-publics montrent pourtant que ses membres sont actifs culturellement ou politiquement, mais via des pratiques culturelles basées sur leur communauté.
Lorsqu’ils sont interrogés sur les pratiques de communication scientifique, les membres des minorités sociales, ethniques et économiques décrivent presque exclusivement les visites de musées. C’est pour eux l’exemple typique et presque unique de ces pratiques. Elles sont perçues comme une forme de culture “élevée” et qui en conséquence ne leur sont ni attirante, ni accessibles.
Pire, certains perçoivent même l’utilisation de ces pratiques par quelqu’un de leur groupe socio-ethnique comme quelque chose de risible, puisque ça représente une intrusion dans une pratique réservée à une élite à laquelle ils ne font pas partie.
Cette perception est révélatrice de la distance sociale existant entre les sujets et les pratiques de communication, et de comment cette distance renforce l’inaccessibilité.
Contrairement à la littérature existante concernant les visites de musées justement, qui affirment pour la majorité que les visites scolaires favorisent l’inclusion, les membres des minorités socio-culturelles qui ont participé à ce type de visites ont le sentiment d’y avoir été mené de force, ce qui réduit fortement non seulement l’intérêt durant la visite, mais aussi l’intérêt pour des futures visites.
La CST devient alors une culture prescrite plus qu’une culture vécue : elle renforce la rupture entre savoirs scientifiques et savoirs de la vie quotidienne.
Une forme d'impérialisme ?
En conséquence de cette vision condamnante des non-publics, les programmes de communication scientifique ne s’intéressent pas ou peu aux besoins, intérêts et pratiques des groupes marginalisés et deviennent au contraire une forme de normalisation vers la culture dominante. Autrement dit, dans ce contexte les pratiques de communication scientifique peuvent devenir un outil de l’impérialisme culturel.
L’impérialisme culturel est défini comme l’imposition de la culture, des visions et des pratiques des groupes sociaux dominants, aux frais des groupes marginalisés.
La communication scientifique est souvent perçue comme outil d’impérialisme culturel à cause de sa tendance à l’eurocentrisme. Elle participe par exemple à la diffusion de préjugés racistes par un partage orienté de l’histoire comprenant une surreprésentation du « blanc sauveur » et des minorités sous le joug de l’esclavage, ou par la sous-représentation de personnalités incarnant des exemples positifs pour ces minorités.
À ces problématiques viennent s’additionner celles des moyens temporels et financiers nécessaires pour participer à ces pratiques, mais aussi à un fort sentiment d’impuissance dans le débat public (qui mériterait un article à lui tout seul).
Le fonctionnement de la communication scientifique aide donc à maintenir les hiérarchies sociales en reproduisant les schémas d’avantages et de désavantages sociétaux via une sélection de qui peut participer ou non, alors même que sa volonté est d’aider à effacer ces inégalités.
La question se pose maintenant de savoir comment la communication scientifique peut sortir de ce schéma, mais surtout si elle le veut vraiment.
Vous voulez en savoir plus ? Cet article est le fruit de la lecture de l'article suivant d'Emily Dawson, disponible en accès libre :
« Reimagining publics and (non-)participation : exploring exclusion from science communication through the experiences of low-income, minority ethnics groups », Emily Dawson (University College of London) in Public Understanding of Science, 21, Vol.27(7), p.772-786 (url : http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963662517750072)