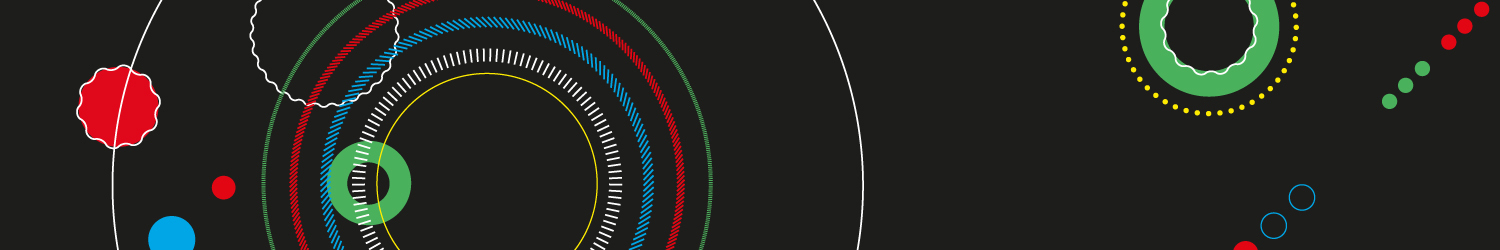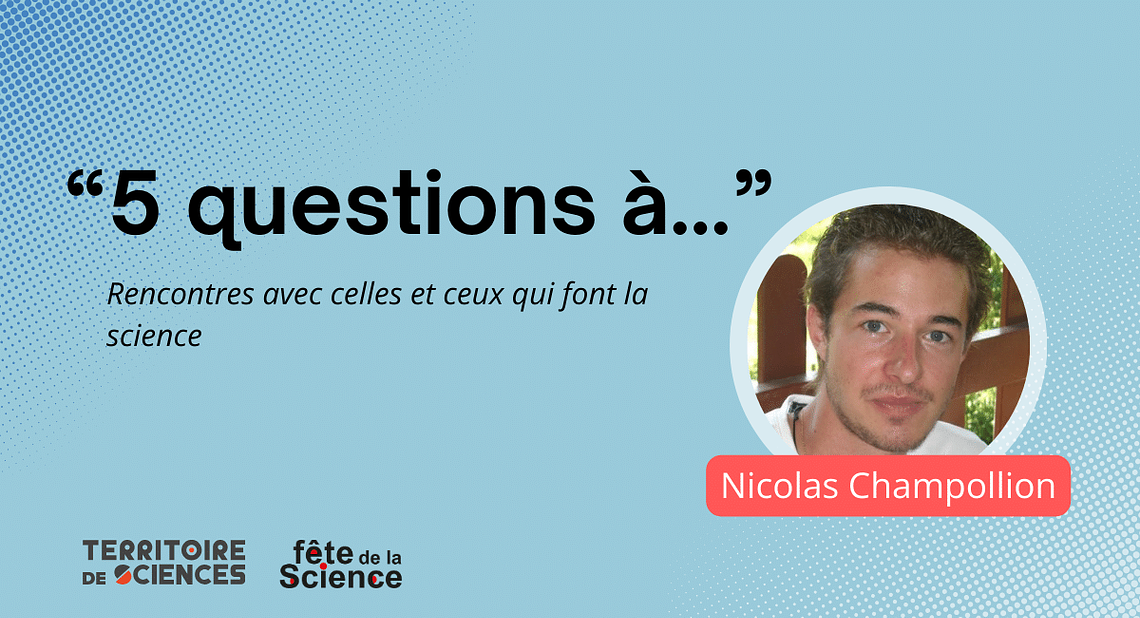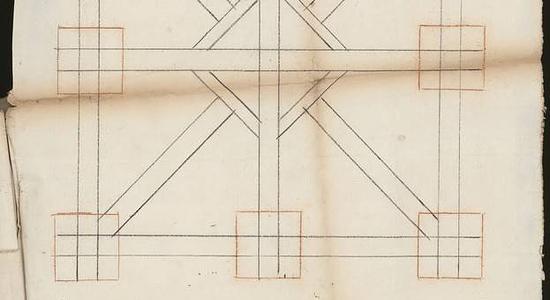5 questions à... Nicolas Champollion
Publié par Echosciences Grenoble, le 14 septembre 2025 820
À travers cette série, nous mettons en lumière les chercheurs et chercheuses qui participent à la Fête de la science 2025 en Isère. L’objectif : découvrir leur parcours, comprendre leur métier et mieux appréhender les enjeux de leurs recherches.
Suite de la série avec Nicolas Champollion, Chargé de recherche en glaciologie et science de la durabilité à l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) de Grenoble.
Retrouvez toutes les informations sur la Fête de la science 2025 en Isère
1. Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la recherche ?
Trois attraits initiaux m'ont, je pense, poussé à vouloir travailler dans la recherche. Le premier est un livre sur le fleuve Amazone, son fonctionnement, sa faune et sa flore, ses merveilleuses photos que je découvris lorsque j'avais une douzaine d'année. Le deuxième est les randonnées alpines que je faisais durant mon adolescence proche et sur les glaciers des Écrins, notamment le glacier Blanc et le glacier de la Maye (glacier peu connu du Valjouffrey).
La dernière est ma curiosité pour les mathématiques, leur beauté abstraite, proche de la perfection dans leur conception et leur réalisation. Ainsi, l'étonnant mélange de tout cela, associé à un environnement familial proche de la recherche et des thématiques environnementales, m'ont probablement donné envie de faire de la recherche !
2. Sur quoi portent vos recherches en ce moment ?
Actuellement, je travaille sur deux aspects distincts (mais qui au final font sens ensemble) : en premier lieu, l'évolution de l'ensemble des glaciers de montagne de la planète en fonction de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre humaines et donc du climat pour le et les siècles à venir.
Plus précisément, j'utilise des approches simplifiées mais cohérentes et globales (simulation sur ordinateur à travers le modèle communautaire Open Global Glacier Model) pour estimer la fonte et l'accumulation de neige et de glace sur les glaciers, ainsi que leur mouvement dynamique, dans le but final de connaître leur état dans les années à venir.
En second lieu, je travaille sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des activités de recherche elles-mêmes, également pour le reste de la société, sur la formation des personnes de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et des scolaires, et enfin sur les freins et leviers aux changements de comportement (avec les ateliers coopératifs "Ma Terre en 180 Minutes").
3. Y a-t-il une idée reçue que vous aimeriez voir disparaître dans votre domaine ?
De nombreuses ! Bien que de bonne guerre, la blague - et parfois l'idée préconçue - comme quoi les chercheurs et chercheuses cherchent mais ne trouvent pas !
Plus sérieusement, pour l'évolution des glaciers, j'en vois deux : l'idée comme quoi la fonte des glaciers est entièrement inéluctable (une partie oui) et que nous ne pouvons rien faire, et deuxièmement que c'est la faute des autres. Tant que nous raisonnerons comme cela en rejetant la faute et en se divisant, nous aurons rien compris !
La responsabilité des émissions de gaz à effet de serre est de l'ensemble de l'humanité avec, évidemment, une gradation en fonction de nos émissions respectives (qui très souvent dépendent de notre niveau de vie) et une courbe exponentielle vers les très hauts niveaux de vie ; en conséquence, nos actions de sobriété pour réduire nos émissions doivent être à la hauteur de nos capacités respectives. Concernant les ateliers coopératifs et les questions sociologiques associées, sans doute que cela soit considéré aussi sérieusement que les sciences naturelles !
4. Comment participez-vous à la Fête de la science cette année ?
Cette année, je présente une maquette montrant le fonctionnement d'un glacier de montagne : les mesures effectuées pour connaître la fonte et l'accumulation annuelle, ses caractéristiques principales, sa morphologie... Pour cela, nous serons à La Casemate de Grenoble pour accueillir le grand public durant une après-midi et montrer cette maquette développée dans notre laboratoire pour les actions de médiation [ndlr : stand "La science du climat… à portée de main" de l'IGE au sein du village des sciences "Saint-Laurent en ébullition"].
5. Menez-vous des actions de médiation scientifique auprès du grand public en dehors de la Fête de la science ? Si oui, sous quelle forme ?
J'effectue de nombreuses activités de médiation sous les formes suivantes : la première et la plus répandue est la réalisation de conférences grand public sur l'évolution future des glaciers de montagne ; la seconde est la réalisation d'activités de travaux dirigés auprès des scolaires, que ce soit lors d'accueil de stagiaire de 3ème et de 2nde au laboratoire, ou en se rendant directement dans les classes ; la troisième est la réalisation de vidéos courtes de vulgarisation ; enfin la dernière est l'écriture d'articles de vulgarisation.
🧠 Question bonus : Si vous deviez représenter l’intelligence avec un objet ou une image, que choisiriez-vous ?
Hum, pas simple !. Peut-être un enfant de 8 ou 10 ans qui joue au loup dans la cour de récréation. Cette image pour montrer l'intelligence humaine non consciente, ou plutôt sans y réfléchir, mais essentielle, à savoir la perception de notre environnement par tous nos sens, l'analyse en direct et très rapide de la situation pour choisir la bonne direction, la bonne course, éviter les obstacles, conserver le sens de l'équilibre et l'orientation temporelle et spatiale... en plus des ressentis, de la gestion des émotions, d'un éveil et d'une réflexion d'une partie du cerveau qui continue lors d'effort et de distraction, la gestion des mouvements de notre corps par le cerveau, le langage (avec d'autres langues si des enfants ont de multiples nationalités). En fait toutes les intelligences de "situation" qui sont moins mises en avant que l'intelligence abstraite de raisonnement par exemple.