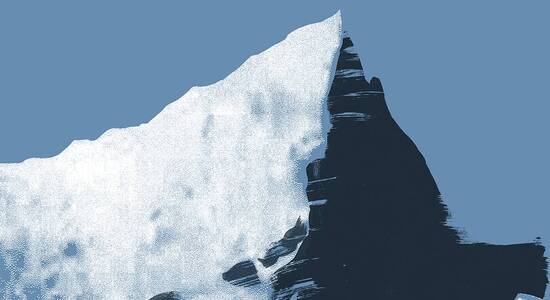Dans les carottes de glace, les traces cachées de la résistance aux antibiotiques
Publié par Institut des Géosciences de l'Environnement IGE, le 8 septembre 2025 2k
Et si les glaciers pouvaient révéler l’histoire cachée de la résistance aux antibiotiques ? Le projet européen Paleo-MARE, soutenu par une ERC Consolidator Grant, explore une question aussi méconnue qu’urgente : comment la pollution aux métaux lourds a pu façonner la persistance des gènes de résistance aux antibiotiques (ARGs) dans l’environnement ?
Pourquoi forer des glaciers pour étudier une menace sanitaire mondiale ?
Les micro-organismes sont au cœur des écosystèmes terrestres. Mais depuis des siècles, les activités humaines — en particulier l’utilisation de métaux lourds (mercure, cuivre, arsenic…) et d’antibiotiques — ont profondément perturbé les communautés microbiennes.
De récentes études montrent que les gènes conférant une résistance aux métaux et ceux conférant une résistance aux antibiotiques se retrouvent souvent ensemble, sur des fragments mobiles d’ADN que les microbes peuvent facilement échanger. Cela signifie que, même en l’absence d’antibiotiques, la pollution aux métaux lourds peut indirectement maintenir la résistance aux antibiotiques dans les populations microbiennes.
Comprendre comment et quand cette co-sélection est apparue est essentiel pour développer de meilleures politiques environnementales et de santé publique. C’est là qu’intervient Paleo-MARE : en analysant des archives naturelles — comme la glace des glaciers et les carottes de sédiments — le projet cherche à révéler l’histoire à long terme de la pollution et de l’adaptation microbienne.
Comment forer la glace pour remonter le temps ?
En mai 2025, l’équipe de Paleo-MARE a franchi une étape clé : le forage réussi d’une carotte de glace au Col du Dôme, sur le Mont Blanc. Ce site, choisi pour son enregistrement séculaire de la pollution atmosphérique en provenance de toute l’Europe, offre une opportunité unique de retracer l’impact humain sur plusieurs siècles.
La mission de terrain a réuni dix personnes : scientifiques, ingénieur·e·s, technicien·ne·s et jeunes chercheur·e·s. En utilisant comme bases la station du Clos de l’Ours et l’observatoire Vallot, l’équipe a transporté le matériel par hélicoptère, installé un site de forage stérile, et utilisé une foreuse électromécanique (limitant les risques de contamination) pour extraire des couches de glace — chacune renfermant de précieuses traces chimiques et microbiennes du passé.
Tout devait être rigoureusement coordonné : s’installer en conditions alpines extrêmes, assurer la sécurité de l’équipe, manipuler et étiqueter les échantillons, maintenir la chaîne du froid pour le transport… afin que la glace arrive intacte pour les analyses en laboratoire.
Qui rend cette science possible ?
Une telle mission repose sur une large gamme d’expertises :
- Glaciologues et géophysicien·ne·s, pour sélectionner les sites de forage et interpréter les signaux environnementaux (avec une contribution majeure des équipes CryoDyn et ICE3 de l’IGE, ainsi que la plateforme F2G).
- Ingénieur·e·s et technicien·ne·s de terrain, spécialisé·e·s dans la manipulation des foreuses et la collecte d’échantillons propres.
- Microbiologistes, géochimistes et bio-informaticien·ne·s, qui traiteront et analyseront les échantillons grâce à la plateforme PANDA de l’IGE.
- Chercheur·e·s en santé environnementale, pour relier les résultats aux risques sanitaires concrets.
- Et une équipe de jeunes chercheur·e·s et doctorant·e·s, impliqué·e·s à la fois sur le terrain et au laboratoire.
Et maintenant ?
Les carottes de glace sont désormais stockées en sécurité et prêtes pour des analyses approfondies. Grâce à des techniques de pointe comme la métagénomique (séquençage de l’ADN), la métabolomique (composition chimique), et la géochimie haute résolution, les chercheur·e·s visent à reconstruire l’histoire des communautés microbiennes face à des siècles d’exposition aux métaux lourds — de l’Empire romain à l’ère industrielle.
Ce travail fait le lien entre paléoécologie et santé publique, en nous aidant à anticiper comment la pollution future et le changement climatique pourraient accélérer la propagation mondiale de la résistance aux antibiotiques — une crise qui cause déjà 700 000 morts par an, et pourrait atteindre 10 millions de décès d’ici 2050.
Contact scientifique : Catherine Larose (CNRS)
Rédaction : Anne Chapuis (CNRS)

Paleo-MARE a reçu un financement du Conseil Européen de la Recherche (ERC) dans le cadre du programme Horizon Europe de l’Union européenne (convention de subvention n° 101088091).