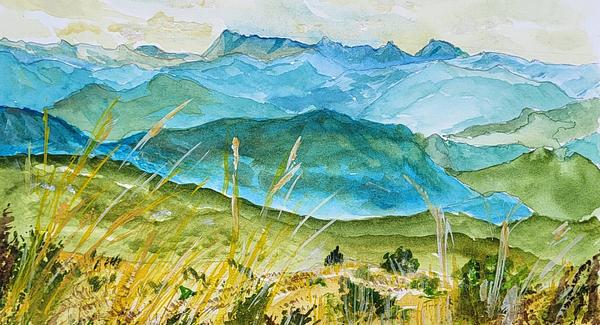Promesses de la visualisation mentale
Publié par Jean Claude Serres, le 28 novembre 2025 1k
La pratique de la visualisation mentale existe depuis le début de l’humanité. Aujourd’hui les neurosciences apportent une compréhension fine de son fonctionnement et de ses effets. Elle est utilisée dans le domaine de la compétition sportive, comme dans le domaine artistique ou le développement personnel. Comme la prose de Mr Jourdain, chacun de nous utilise cette faculté humaine dans son quotidien. Pourtant le concept prête à de multiples confusions. Une déconstruction sémantique peut être utile pour clarifier le propos.
Significations de l’expression “visualisation mentale”
Le premier terme focalise notre attention sur la vision, le visuel, les images, le film et aussi sur l'imagination et l'imaginaire. 5 % de la population n’a pas la capacité cognitive de visualiser une image (impossible, flou, simple contour…).
Le second nous dirige vers les facultés mentales, la mentalisation, le mental, l’esprit comme la dimension intellectuelle et aussi dans une forme de dissociation avec le corps et le biologique.
Nous pouvons porter un autre regard sur l’usage de ces deux termes :
a) le premier concerne une sorte d’état, de résultat ou encore de substance.
b) le second regard est de l’ordre du processus : visualisation , action d’élaborer, de construire, d’organiser, de réaliser, d’imaginer, de représenter une vision, une action, un résultat, une situation, une attente, un désir, une “représentation mentale”.
En première analyse, une visualisation mentale pourrait signifier l’élaboration d’une représentation intellectuelle ou dans l'esprit, distincte du biologique. Une seconde interprétation de l’expression peut signifier l’observation mentale d’une image ou d’un film qui se présente à notre conscience.
Interprétation non dualiste (corps - esprit) de la visualisation mentale
Quand le cerveau reconstruit un souvenir du passé à partir des réseaux synaptiques primaires pour les faire advenir sous forme d’un état conscient, il élabore une représentation mentale qui s'inscrit dans l’instant présent. Pour un souvenir de marche à pied ou de course, il utilise les mêmes réseaux synaptiques qui ont servi à activer la marche ou la course dans le passé, mais à un niveau de stimulation plus faible que celui qui déclenche le mouvement réel.
Quand nous élaborons une représentation mentale d’un projet imaginaire, quand nous imaginons une activité de marche ou de course, le cerveau utilise les réseaux synaptiques déclencheurs du mouvement. Cette perspective révèle que la visualisation mentale agit dans ce cas sur les synapses motrices et peut ainsi les entraîner, les développer. Il en est de même pour l’évolution des connaissances. La visualisation mentale mobilise les zones qui vont permettre d’apprendre, de mémoriser, d’interconnecter, d’imaginer et de développer de nouvelles connaissances.
Extension de l'expression “visualisation mentale “
Le vocabulaire de cette expression canalise celui qui l’utilise sur la dimension de l’image et du film qui aujourd’hui envahissent nos cerveaux via l’usage des mobiles, des écrans et de la réalité virtuelle, l’univers des jeux. Hors l'expression “visualisation mentale” recouvre divers domaines de perception et d'élaborations mentales :
| remémoration de souvenir “imagerie du présent” |
imagination projection invention |
|
| activité sportive |
gestes, environnement, circuit, concurrence |
apprentissage des gestes conditionnement identifications de stratégies |
| activité artistique |
représentation de musique sonore ou visuelle (partition) |
création musicale à l'oreille ou écrite sur la portée |
| activité intellectuelle |
approche auditive ( récit, logique argumentaire ) ou visuelle (pensée paysage, heuristiques dialogiques ) |
élaboration rationnelle ou intuitive, raisonnée ou élaboration cartographique, paysage, en interactions |
| activités affectives |
prise en compte des émotions, des affects, des perceptions gustatives, parfums, des couleurs etc. |
inventions de parfums, de mets recettes, imagination d’une vie amoureuse, de relations érotiques, etc. |
Pour certaines personnes, il sera sans doute pertinent de remplacer l’expression visualisation mentale par ce qui est la plus adaptée pour lui : vision/cartographie mentale, représentation mentale, représentation spirituelle, imaginaire ou imagination artistique, imaginaire musical, etc. Cependant, dans cet article je vais poursuivre en gardant l'expression visualisation mentale dans le sens d’une élaboration mentale réelle ou imaginée.
Les apports de neurosciences
Dans ce domaine, on peut s’appuyer sur les apports de Lionel Naccache (“Le cinéma intérieur”) de Stanislas Dehaene (“code d'accès à la conscience”, et le concept d’espace global de travail conscient) et de Alain Berthoz (“la simplexité”) comme base de départ. Pour approfondir le champ d’étude de la visualisation mentale, les apports de Jean Philippe Lachaux(“ le cerveau attentif” et “dans le cerveau des champions”) et ceux de Aymeric Guillot dans son travail de recherche très pointu sur imagerie mentale(les pouvoirs insoupçonnés de la visualisation mentale) .
Quatre concepts essentiels sont à considérer et à mettre en interaction : Conscience - Attention - Représentations mentales - Plasticité cérébrale. Ce sont les processus ou familles de processus qui vont permettre d’élaborer des visualisations mentales performatives : apprentissages, renforcements musculaires, libération ou renforcement de l’énergie musculaire, récupérations détruites ou endommagées par des accidents vasculaires, aide à la récupération de traumatismes et à la réduction de douleurs, etc. Cela peut paraître miraculeux ou magique. Cependant il ne faut pas sous-estimer la durée de mise en œuvre comme la bonne compréhension afin de ne pas avoir des résultats contraires à ceux recherchés.
Conscience :
Nous avons l'illusion d’une conscience continue mais en fait c’est une succession d’états de conscience qui occupe l’espace global de travail conscient.
Pour donner un exemple, prenons celui de la reconnaissance d’un visage. Au niveau des processus cérébraux non conscients réseaux de neurones concernés les circuits concernés mobilisent des millions de configurations informatives. Par propagation dans les deux hémisphères, les processus intermédiaires condensent l’information. Pour accéder à l'espace global de travail conscient le volume d’information sera réduit à un vecteur de 50 dimensions.
Afin que ce processus débouche à l’état conscient les différents étages sont mobilisés par des états attentionnels. L'espace global de travail conscient ne présente que très peu d’états simultanés. Les processus de raisonnement sont par exemple très linéaires et analytiques.
Attention :
Les processus attentionnels sont multiples et jouent différents rôles. Dans l’exemple de la pratique de méditation on peut distinguer la méditation de pleine conscience. Dans ce travail la personne se place en posture de non attente, de non désir, simplement en observation de ce qui se passe dans l’espace de travail global. Elle peut ainsi repérer son souffle respiratoire sans le modifier, des états de tension musculaire, des flux de pensées qui se succèdent sans interagir. On désignera cet état de posture d’attention flottante, une posture méta en quelque sorte.
D’autres postures attentionnelles induiront des méditations porteuses d'intentions. Ce seront des processus d’attention focalisés, de forte concentration. En préparation sportive ce sont ces types d'attentions qui vont permettre de créer des visualisations mentales conscientes pertinentes. Par contre elles seront peut être inadaptées au moment de réaliser l’acte sportif lui-même. On peut distinguer 4 familles de processus attentionnels : Vigilance , immersion, fidélisation, de projet
Représentations mentales :
La visualisation mentale performatrice sera en concurrence dans l’espace global de travail conscient avec une multitudes d’autres représentations mentales stimulées par des postures de déconcentration liées à des émotions, des perceptions externes , des désirs ou intentions non conscients. La pratique méditative sous ses différentes formes peut produire des états de conscience naturels ou modifiés qui seront dirigés sur des attentes précises, singulières.
Pour donner un exemple souvent utilisé et pratiqué : prendre un verre et boire en conscience signifie que toute l’énergie attentionnelle est focalisée sur la succession de gestes qui vont permettre de prendre le verre, boire avec concentration et reposer le verre en délicatesse. Faire ce geste juste est très bien illustré dans le livre de Bernard Amy (“pour la beauté du geste”)
Plasticité cérébrale :
Les processus d’apprentissage et de conditionnement cérébraux sont possibles par cette plasticité neuronale de reconditionnement des circuits neuronaux ( activation/ inhibition) et de transformation des liaisons synaptiques. C’est à ce niveau que la visualisation mentale agit de façon “magique”. Dans la pratique sportive la pratique de la visualisation d’un geste particulier peut compléter et accroître la puissance, la force que l’on développe habituellement par l'entraînement réel. La visualisation mentale active les circuits neuronaux actifs pour déclencher les gestes.
Nous pouvons percevoir ainsi tous les apports neuroscientifiques à une bonne pratique de la visualisation mentale. Je vais maintenant illustrer quelques mises en pratique concrètes.
Application pratique de la visualisation mentale en sport
Nous pouvons distinguer plusieurs types de visualisation :
Pour développer la performance d’un geste (force, rapidité, énergie optimisée) le sportif se concentrera sur le geste proprement dit, voire le muscle (visuellement, proprioception, etc.)
Un autre acte de visualisation mentale consiste à se percevoir globalement en train d’effectuer le geste, vu de l'extérieur comme un spectateur. c’est une action de contrôle ou de posture globale (équilibre, etc.)
Application pratique de la visualisation mentale en développement de compétences
Nous pouvons visualiser à une ou plusieurs années la ou les compétences que l’on souhaite développer. Plus la visualisation est précise et plus elle s'inscrit dans la mémoire, plus le cerveau non conscient sera à même de faire apparaître à la conscience les opportunités de progression. Cette vision devient vivante et s’auto anime !
Sur un autre plan, plus stratégique, au fil du temps, de la vie de chacun il peut être pertinent de visualiser (schéma) la courbe de maturation qui ne cesse de croître au fil des années et qui croise la courbe de vieillissement qui commence dès la naissance (pollution environnementale et nutritive, contraintes éducatives toxiques, etc). Chacune des courbes présente des successions de cuvettes d’équilibre et de zones de déséquilibre ou remises en question ( bifurcations cognitives en phase de maturation) et catastrophes métamorphoses en phase de vieillissement ). Souvent, les plateaux et les bifurcation sont en alternance entre les deux courbes mais ce n’est pas toujours le cas.
Application pratique de la visualisation mentale en accompagnement
De nombreuses applications sont liées au développement de compétences. Un exemple très pratique de visualisation est celui de l’outil “bonhomme allumette”. Si l’on dessine un bonhomme (soi même) et un objet toxique (la cigarette) si l’on veut arrêter de fumer, la mise en œuvre de l’outil ira à l’inverse du projet. Le fait de fumer sera déculpabilisé ! La bonne pratique sera de visualiser le bonhomme allumette actuel ( fumeur) et le bonhomme futur (qui ne sera plus fumeur). les liens qui seront valorisés seront pertinents et les liens de dépendances ou d’attachement seront plus facilement coupés.
De façon plus globale l’élaboration d’une vision synthétique de sa situation personnelle par rapport au poids du passé, du présent et de son futur (plan développement ) peut permettre d’engager les actions pertinentes à mettre en œuvre. Le schéma ci-dessous présente une cartographie globale des mémoires du passé, du présent, du futur(antérieur !) et de la stratégie d’action. Suivant le poids du passé et des traumatismes vécu, présent, futur et stratégie resteront la part pauvre de l’imaginaire. La représentation du futur est la visualisation mentale projetée sur ce que l’on désire dans les prochaines années et que l’on est en mesure de maîtriser ou d'influencer : développer une compétence, réaliser un grand voyage, imaginer une nouvelle vie en couple, etc. Cet imaginaire habite la “mémoire du futur” depuis un certain temps et se peaufine au fil du temps.
Un équilibre sain entre représentation de chaque mémoire est souhaitable :
- le poids du passé (livre d’or, échecs, moments de joies et de souffrances
- le poids du présent de la situation globale et locale, des enjeux sociétaux, l’avenir (le futur que l’on ne maîtrise pas )
- le poids du futur personnel désirable (que l’on maîtrise ou que l’on peut influencer)
Un autre type de cartographie peut aider à détecter les zones d’équilibre ou de déséquilibre et d’attachement dans l'éventail des désirs qui nous anime.
En synthèse
Il me paraît très souhaitable de développer une compétence large de visualisation mentale en intégrant les différentes méthodes pratiques, voire stratégiques, en gardant le réflexe de l'esprit critique apporté par les sciences, en particulier les neurosciences et la psychologie cognitive. Cette démarche peut être une contribution majeure, un contrepoids aux impacts de la numérisation agressive et ultra rapide de la société pour apaiser le cerveau humain trop sollicité d’informations (pertinentes ou non). Cela s'inscrit dans dans une forme d’écologie de l’attention ou les arts de l’attention (Cf Yves Citton).