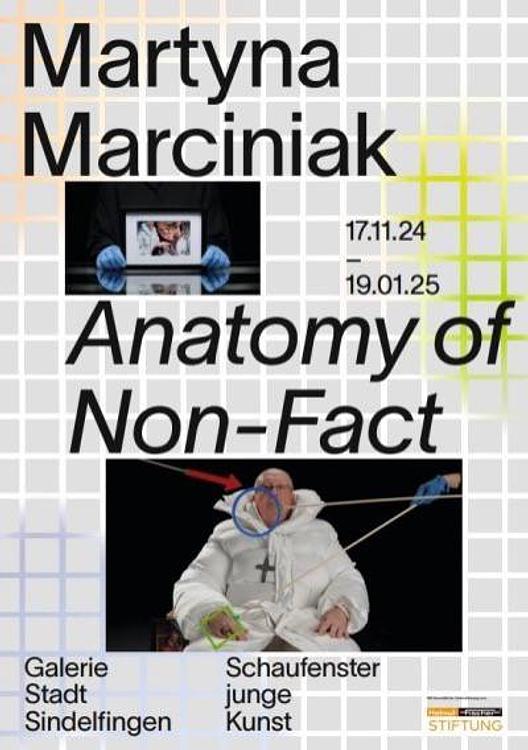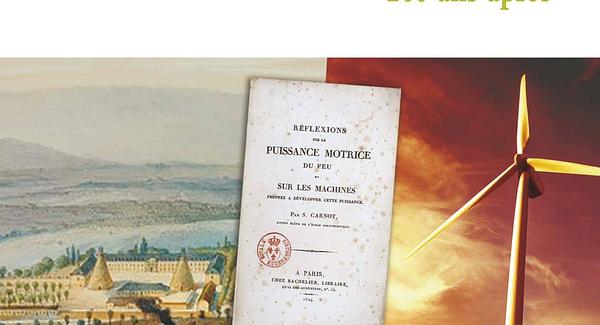Au-delà du « fake » : l’œuvre « Anatomy of non-fact » de l’artiste Martyna Marciniak explore les images synthétiques
Publié par Joel Chevrier, le 14 octobre 2025 620
Martyna Marciniak : « examiner comment le design et la technologie façonnent les idéologies et les structures sociales »
En 2025, Martyna Marciniak est en résidence au CERN à Genève, en lien avec le Copenhagen Contemporary. Le CERN la présente ainsi : « La pratique interdisciplinaire de Martyna Marciniak combine narration spatiale, fiction spéculative et reconstitution 3D pour examiner comment le design et la technologie façonnent les idéologies et les structures sociales. » Son travail, au cœur de notre temps, pointe comment une puissante alliance entre le design, la technologie et la science, somme toute, ce que l’on appelle « La Tech », induit une transformation inéluctable et massive du monde. Avec cette artiste, on se demande qui est en mesure de contrôler, voire même de mesurer sinon d’anticiper ces transitions.
Un pape en doudoune Balanciaga, ça n’existe pas…
En 2023, une image représentait le pape François vêtu d’une doudoune Balenciaga. La réaction planétaire déborda son auteur, Pablo Xavier, grand fan de l’I.A. Mid-Journey. Bien sûr pour lui, cette image dite synthétique était évidemment un « fake » issue de ses jeux avec l’I.A. Mais pas pour le reste du monde, qui n’avait pas pris la mesure de la brutale transition en cours. La production rapide et la diffusion planétaire instantanée de toute image synthétique est devenue accessible à chacun sans aucune formation spécifique, aucune compétence remarquable. Avec son œuvre « Anatomy of non-fact », Martyna Marciniak explore en artiste cette évolution radicale de notre relation à l’image.
Photographies, ou images optiques, versus images synthétiques, ou images non-optiques
L’image synthétique est complètement déterminée par la science et la technologie, mais à la différence de la photographie, ou imagerie optique, inutile de prendre une photo d’une scène réelle pour l’obtenir. La photographie issue du XIXèmesiècle permet l’enregistrement sur écran des images optiques, grâce à une ingénierie physique et chimique. Elle résulte de processus photochimiques, interactions réelles de la lumière avec la matière. La photographie est donc physiquement contrainte : le réel s’impose à elle. Avec l’imagerie synthétique, ce n’est plus vrai. Son ingénierie est celle des nanotechnologies, de l’informatique, du traitement massif et rapide des données et donc de l’I.A. Elle travaille les données numériques sur un écran digital, support de l’image, et peut générer toutes les images possibles. Grâce à l’I.A., est sur l’écran ce que son auteur a décidé d’y mettre au pixel près, dans une liberté totale.
Mise en abyme : un faux pape en doudoune Balenciaga, certes faux bien réel
AI Hyperrealism trailer
Dans une vidéo, Martyna Marciniak présente alors une personne, bien réelle, qui ressemble au pape François. Cette personne est habillée avec une vraie doudoune Balenciaga. L’artiste pousse ainsi un cran plus loin le « fake » constitué par l’image de synthèse de Pablo Xavier. Elle relie au monde réel cette situation imaginaire qu’il nous donne à voir, en la mettant en scène a posteriori. Mais cela reste un « fake » : ce n’est évidemment pas le pape François lui-même, alors en vie, qui s’est promené ainsi à la demande de Martyna Marciniak. C’est donc une scène bien réelle que filme classiquement Martyna Marciniak. Cette image optique devient l’enregistrement fidèle de la matérialisation et de l’incarnation, jouées dans le monde réel, d’une « image synthétique » totalement artificielle, selon ses mots, une image « post-optique » ou « non-optique » mais époustouflante tant elle est immédiatement crédible. La mise en abyme est vertigineuse.
Le premier temps de l’image : le dessin, la peinture et la gravure
L’expression « image non-optique » utilisée par Martyna Marciniak articule l’évolution des images autour de la photographie née au XIXᵉ siècle. Avant, les images produites par l’humanité sont des dessins, des peintures ou des gravures. L’artiste, par la peinture, le dessin ou la gravure, met sur une surface ce qu’il veut. Il n’y a pas d’autre contrainte que la technique de l’artiste, même si elle est sévère. Ce que veut un peintre, c’est aussi ce qu’il est capable de peindre. Ce travail, disons sur « l’apparence du réel », et ce quel que soit le style, de Botticelli à Picasso en passant par Rembrandt, remplit les musées. Une multitude de styles, d’histoires, de narrations, de révolutions artistiques témoignent de ce foisonnement inouï de la création humaine.
Joseph-Philibert Girault de Prangey, les premières images optiques d’Athènes

Façade et colonnade nord du Parthénon sur l'Acropole, Athènes. Daguerréotype de Joseph-Philibert Girault de Prangey (1842)
Après l’invention de la photographie située en 1839 avec Nicéphore Niepce et Louis Daguerre, la qualité et les conditions d’enregistrement progressent à une vitesse folle. Dès les années 1840, Joseph-Philibert Girault de Prangey produit les premières images optiques d’Athènes, de Jérusalem, ou du Caire. Roger Fenton photographie la guerre de Crimée en 1855. Les photographes de guerre risquent leur vie pour couvrir les conflits sur toute la planète. La formule de Robert Capa est terrible : « Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c’est que vous n’êtes pas assez près. »
La photographie sera, pour environ deux siècles, une pierre de touche. Pour tout le monde, une photographie est une image du réel, un témoignage indiscutable. Bien sûr, on a falsifié des photographies, mais tromper son monde n’était pas techniquement si simple, et finalement, ces tentatives sont la reconnaissance de ce statut des « images optiques », statut garanti par la physique et la chimie.
De l’image optique à l’image synthétique au XXIème siècle
Les milliards de smartphones sur Terre augmentent phénoménalement le nombre de photographies, d’images optiques ! Mais désormais, elles vont s’inscrire dans l’univers des images synthétiques. Toutes les transformations numériques des photographies sont possibles lors de la prise d’image et ensuite. La différence entre les images synthétiques et les photographies devient difficile à discerner, mais ce sont les images synthétiques qui deviennent la norme. Alors, en ce début du XXIᵉ siècle, on pourrait avoir l’impression d’un retour à l’époque d’avant la photographie : celle où toutes les images étaient de pures créations humaines. De fait, le créateur redevient celui qui décide de tout. Avec une I.A., il peut choisir ce qui est sur l’image pixel après pixel. Mais on est très loin d’un simple retour en arrière. Le travail de Martyna Marciniak le souligne.
L’image synthétique entre peinture et image optique ?
Au XIXᵉ et au XXᵉ siècles, la photographie a tout emporté en combinant notamment la représentation d’une scène réelle, la rapidité d’exécution, la facilité de mise en œuvre, la diffusion et la reproduction en masse. Mais la photographie, image optique, pourrait bien être emportée à son tour. Si l’image synthétique peut avoir exactement l’apparence d’une photographie, d’une image optique, elle est aussi une création, et en cela sa production s’apparente au processus créatif à l’œuvre dans la peinture. Aujourd’hui, littéralement, n’importe qui peut créer, sans apprentissage, des images d’une qualité irréprochable. Et c’est bien ce qui est arrivé à Pablo Xavier, qui a créé l’image du pape François en doudoune Balenciaga. De plus, il n’y a plus vraiment d’original. Toute copie exacte du fichier source issu du logiciel d’intelligence artificielle est identique à ce fichier initial. La diffusion sur les écrans n’est pas une copie, mais l’affichage de l’œuvre elle-même. Avec des milliards d’écrans et des représentations aux détails époustouflants, l’accès aux œuvres devient d’abord limité par la navigation dans une masse écrasante d’images synthétiques produites à jets continus, partout disponibles at à chaque instant. Il va falloir des guides I.A. pour choisir ce que l’on souhaite, d’une part, produire, mais d’autre part, voir.
Mais si ...
Martyna Marciniak avec cette œuvre, Anatomy of Non-Fact, ne nous met-elle pas devant un abyme encore plus profond ? Délibérément ? Il n’y a pas de raison de douter que sa vidéo soit issue d’un tournage avec un acteur, une mise en scène et une caméra. Elle nous le dit, on peut la croire. Mais comment pouvons-nous encore en être sûr ? Si elle avait en fait généré cette vidéo en utilisant une I.A., serions-nous capables de faire la différence ? Et surtout, quelle différence cela ferait-il… ?
L’aide de Jean Baudrillard pour explorer le « fake » ?
Dans son livre « Simulacres et Simulation », le philosophe et sociologue Jean Baudrillard écrivait : « … feindre, ou dissimuler, laissent intact le principe de réalité : la différence est toujours claire, elle n'est que masquée. Tandis que la simulation remet en cause la différence du vrai et du faux, du réel et de l'imaginaire. »
En reprenant cet ouvrage « Simulacres et Simulation », pour mieux suivre Martyna Marciniak, il vient à l’esprit que, dans l’ère des images synthétiques — elles-mêmes performatives dans le monde réel et/ou virtuel — la notion même de « fake » n’est pas définie dans un rapport à la réalité ou au vrai.
D’ailleurs, dans ce livre de 1961, Jean Baudrillard a déjà introduit quatre phases successives de l’image :
« Telles seraient les phases successives de l’image :
- elle est le reflet d’une réalité profonde
- elle masque et dénature une réalité profonde
- elle masque l’absence de réalité profonde
- elle est sans rapport à quelque réalité que ce soit : elle est son propre simulacre pur. »
« Dans la quatrième phase, l’image n’est plus du tout de l’ordre de l’apparence, mais de la simulation. »
L’image « fake » produite par l’I.A. a depuis longtemps franchi le niveau deux, passé le niveau trois, et probablement atteint le niveau quatre.
Le livre de Baudrillard s’ouvre sur une citation imaginaire de l’Ecclésiaste :
« Le simulacre n’est jamais ce qui cache la vérité – c’est la vérité qui cache qu’il n’y en a pas. Le simulacre est vrai. »
Légende de l'image en tête: Cette exposition mettait au centre des images numériquement générées par intelligence artificielle, comme celle du pape François portant un manteau de la marque de mode Balenciaga
Cet article est la traduction française de la publication originale par la revue Interalia Magazine à Londres.
Ce regard sur l’oeuvre de Martyna Marciniak est la conséquence d’une rencontre cette artiste à Bruxelles lors d’un séminaire de travail du réseau "Studiotopia: Art meets Science in the Anthropocene" dont l’Hexagone de Meylan est un des partenaires au côté notamment de Ars Electronicaà Linz et de Bozart à Bruxelles. L’Hexagone m’a invité à collaborer avec eux en tant que scientifique au sein de ce réseau.