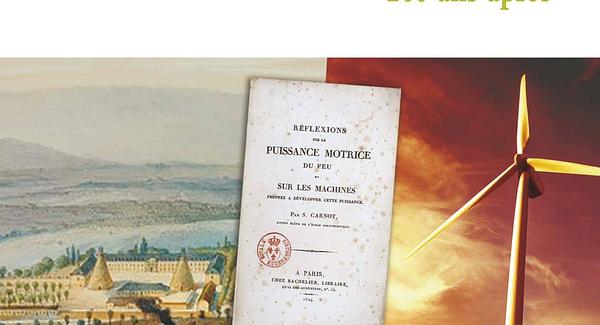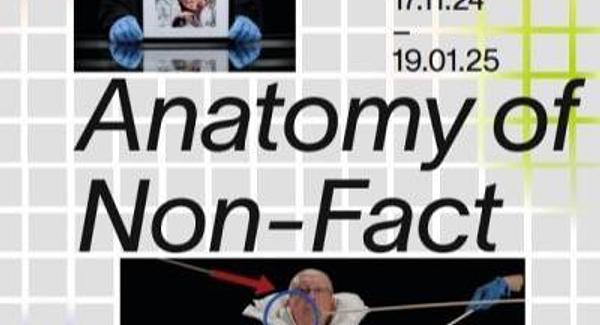La venue de l’avenir de Cedric Klapisch: la photographie aura été une technologie planétaire profondément humaine
Publié par Joel Chevrier, le 28 juillet 2025 2.8k
L’humanité s’est appropriée la photographie qui a enrichi les relations humaines, cœur de notre humanité. La transformation du monde par cette technologie a été émancipatrice. Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, dernier regard en arrière avant la bataille de l’avenir ?
Les transitions, nous sommes dedans déjà. Climat, biodiversité et technologie. Devant cet avenir à tout le moins incertain, sinon menaçant, le film de Cédric Klapisch nous propose un regard environ 150 ans en arrière. Dans cette histoire, la photographie naissante apparaît déjà comme celle des photos d’album de famille et des portraits sur les buffets de salle à manger. Ce film est un dernier regard en arrière avant l'inconnu de l'irréversible des transitions en cours.
D’abord ce film expose une thèse. A tout instant, pendant tout le film.
En 1890, la photographie, inventée en 1840, commence à envahir le monde. Probablement première des technologies à le faire à ce point et à cette vitesse, elle va en deux ou trois générations profondément transformer les relations familiales, amicales, toute l’humanité en fait. Mais dès sa montée en puissance, cette transformation est le résultat d’une appropriation populaire. La place des photographies, dans les albums de famille, encadrées sur les buffets sera celle définie par tout un chacun. Cette technologie n’apparait pas ici comme accompagnée d’une volonté de manipuler l’humanité comme le fait pratiquement explicitement la Tech d’aujourd’hui avec une captation de l’attention. Dans son film de 2024, Eddington, Ari Aster explore la déshumanisation violente à l’œuvre avec les réseaux sociaux, les smartphones et l’IA. Dans le film de Cédric Klapisch, si la photographie transforme les relations humaines, aussi entre les générations, le résultat apparaît comme l’ouverture de nouvelles interactions entre les personnes, avec en conséquence, une intensification des relations familiales, amicales, sociales… Par contre, le regard proposé ici sur notre futur n’indique pas un tel renouveau mais au contraire la mobilisation de la famille, de l’éducation, de l’écrit et de l’art pour engager la bataille contre les technologies qui viennent abimer ces relations. Les deux films, celui de Ari Aster et celui de Cédric Klapisch ne sont pas si loin à cet égard. Cédric Klapisch veut nous laisser une chance. Pas Ari Aster…
La photographie. A travers le temps, à travers l’espace.
Et pour constituer cette thèse, l’auteur procède par ajout de touches successives un peu comme le fait l’impressionnisme en peinture, lui-même un élément important de l’histoire.
Deux périodes alternent dans le film. La nôtre, aujourd'hui donc, celle du numérique, des smartphones, des réseaux, de l'IA qui vient à grande vitesse. Et la France autour de 1890 dans laquelle un changement majeur est en train de s'installer : le développement de la photographie. Elle a été inventée un demi-siècle plus tôt. Elle est déjà partout mais encore l'affaire exclusive de professionnels à l'image de Fred Testo qui campe le photographe star de l'époque, Félix Nadar et du jeune photographe joué par Vassili Schneider. Bien sûr nous connaissons le résultat en 2025, tout le monde fait des photos. Cédric Klapisch dans son générique de fin parcourt ce presque siècle et demi avec des photos par dizaines, prises par une multitude d’appareils différents. Ces parcours photographiques racontent des vies, des histoires comme tout le monde le fait dans les mariages, les départs à la retraite, les décès… il faut rester dans la salle après la fin du film.
Et la photographie va tout changer
Cédric Klapisch situe l'action avant l'explosion de la photographie, 50 ans après son invention. Mais la partie est déjà jouée. La photographie est partie pour tout changer. Le film, à mes yeux, tourne autour de cette seule idée. Comme le souligne le jeune photographe dans le film, cette technologie est en fait un simple enregistrement par la chimie de la lumière renvoyée par le monde réel sur une surface photosensible. C’est sur ce capteur bidimensionnel que le contrôle optique, par les lentilles et les miroirs, permet de former ce que la physique nomme « image réelle». La technologie de ce dispositif évolue encore aujourd’hui, mais le résultat est époustouflant dès 1840. La photographie change tout de l'image, massivement. Et elle évolue en un temps très court. A tous les niveaux : la précision et la résolution de l’image, sa production, sa diffusion, et donc sa présence. Le film le souligne avec force, la photographie est d'abord ce que les gens en ont fait depuis son invention jusqu'à aujourd'hui. Sa définition, sa place, son installation sont le résultat d’une appropriation par tous. Les images de synthèse, celles faites sans appareil photo, produites par les I.A. ouvrent une ère radicalement différente. Voir à cet égard le travail remarquable de la jeune artiste Martyna Marciniak. Le film l’évoque en une touche rapide : le jaune de la robe jure sur la photo prise devant les Nymphéas, mais il ait dit alors qu’il suffira de modifier les couleurs du tableau de Monet par un traitement numérique a posteriori. La question de l’appropriation, du contrôle du cerveau et du corps des personnes par les images est désormais posée dans des termes nouveaux. Une période qui aura durée 150 ans se ferme.
Tout le film suit cette exploration de l’arrivée de la photographie
Cette thèse sur la place de la photographie et sur son appropriation populaire, positionne tout le reste du film. Il est constitué d’une multitude de courtes scènes, souvent seulement posées, mais à l'époque des séries chacun les finit instantanément de lui-même. Ainsi le personnage de Vincent Macaigne s'empare d’autorité du smartphone du personnage de Julia Piaton, pour la sortir de l'écran qui l'ancre dans une rupture qui n'en finit plus. Et c'est tout. Ça va vite, mais le message est clair. Après l’appareil photographique, c'est le smartphone. Vingt ans après son arrivée dans nos poches, son usage populaire ne permet pas vraiment de distinguer les formes d'appropriation positives que nous pourrions inventer pour ne pas subir la manipulation psychologique de l'attention à grande échelle. Cédric Klapisch n'est pas optimiste à propos des technologies du XXIèmesiècle. Dans Eddington, Ira Aster est carrément noir.
La peinture, la magie et l’écriture sont là autour de la photographie
Ces trois éléments s’articulent autour de la photographie pour construire la structure du film. Au passage, on reste impressionné par la sophistication du scénario et de la narration. Je regrette quant à moi de ne pas être capable de distinguer comment cette sophistication est installée dans le film, son découpage et son montage. Je ne peux que pressentir cette recherche.
L’impressionnisme, une peinture du temps de la photographie ?
Claude Monet est un personnage central du film de même que le tableau Impression, soleil levant. Entre peinture et photographie, le propos de Cédric Klapisch est clair, et en fait assez classique. Après la photographie, la peinture devient un art obsolète, on n'en voit plus l'intérêt eu égard à la précision, à la résolution et à la puissance de la photographie devant le réel. C’est en substance ce que déclare avec aplomb le personnage de Vassili Schneider, jeune photographe enthousiaste. Réponse de son ami, jeune peintre incarné par Paul Kircher : la peinture est ailleurs, sa place dans l'humanité est ailleurs. Et d’ailleurs suivre le peintre dans cet ailleurs nous oblige comme le dit Georges Didi Huberman à réinventer notre langage pour être ensemble devant le tableau. Là, le personnage de Cécile de France, une historienne d'art plus vraie que nature, propose une réinvention radicale de son langage pourtant si sophistiqué par ailleurs. Projetée en 1870 par les hallucinations dues à l’ayahuasca, cette potion des chamans d'Amazonie, elle rencontre devant le tableau Impression, soleil levant, le critique Louis Leroy qui donna son nom à l’impressionnisme. Elle lui casse la figure tant ses propos devant le tableau lui sont insupportables. Cela doit s’appeler la force de la peinture…
La magie
L'arrivée de cet épisode du télescopage entre les époques,1870 et aujourd'hui, m’a surpris. Il a pourtant une place importante. Déjà, il permet de faire avancer le film à grand pas. Certainement très intéressant dès l’écriture du scénario. Au-delà, cet épisode nous fait faire un bond dans un passé lointain, largement avant la photographie, avant même l’écriture, ce temps où l'humanité produit des mythes, des religions et des magies donc, et construit ainsi des sociétés. Le personnage de Vincent Macaigne, accroché au chamanisme, conduit à faire l'expérience de l’ayahuasca. Un sommeil peuplé d’hallucinations est un médium très efficace pour voyager dans le temps, faire se télescoper les périodes. Cédric Klapisch remet ici en scène la magie, sortie de la nuit des temps face à toutes les technologies qui investissent les relations humaines pour les transformer. La question de sa relation au réel n'est pas le sujet. Le personnage incarné par Zinedine Soualem, un vieux professeur, à l’image de ces instituteurs que l’on appelait les hussards noirs de la République déclare son incrédulité et règle son compte au problème en une courte réplique. Évidemment, ce n’est pas la question ici. En appelant la magie à la rescousse, le film s’ancre dans l’histoire longue de l’humanité : comment être ensemble, comment être une famille, comment être amis, comment se rencontrer ? Probablement en se racontant des histoires qui deviennent un regard profond et partagé sur l'existence, sur l'absence, sur le temps qui passe. Après l’écriture, la photographie vient à son tour transformer ces questions fondamentales aussi vieilles que l'humanité.
L’écriture
Le fil que tire le film autour de l'écriture est très beau. Il l'installe par brèves touches dispersées au long du film. L’écriture apparaît la première dans le film. Le personnage de Suzanne Lindon dit à son fiancé qu’elle lui enverra des lettres. On est en 1890 dans la campagne normande. Il lui rétorque qu’elle ne sait ni lire ni écrire. Mais elle veut absolument apprendre à lire et à écrire. On apprend à la fin du film qu’elle finira institutrice dans le 20e siècle naissant. Ailleurs on voit écrire une institutrice de village au XIXème siécle. La beauté de sa calligraphie (encrier, porte-plume et plume Sergent Major) tire des larmes surtout quand on est un spectateur de plus de soixante ans comme Cédric Klapisch. Le départ à la retraite du professeur de français en 2025 est un moment d’anthologie. Ces moments d’expression de grande gratitude existent plus qu’on pourrait le penser. La figure du professeur semble garder une grande force pour chacun, malgré tout. Et puis en passant, comment mieux convoquer l’écriture, force de transformation du monde, sinon avec un François Berléand que l’on sent hilare, qui campe un Victor Hugo dragueur qui ne doute de rien. On le reconnaît bien là. Une minute si drôle.
Conclusion
La venue de l'avenir, dans sa période 1890, part de cette magie, s’appuie sur une peinture éternelle et universelle et donc sur l’art, passe par l'écriture et donc souligne la place centrale de l’éducation pour explore la révolution de la photographie. Le cinéma suivra le mouvement, sa naissance est évoquée en quelques secondes. Le film tire tout droit entre 1870 et nos jours. Les drames de l’histoire sont posés au passage, mais il ne faut pas rater les références tant c’est rapide. C’est une thèse, pas une fresque historique sur quelques 150 ans. Et la thèse du film est donc que la transformation du monde par la technologie a été cette fois-ci émancipatrice, que l’humanité s’est appropriée l’écriture et la photographie pour enrichir les relations humaines qui font notre humanité.
Quand il s’agit du XXIème siècle, le ton change. On sent une inquiétude, une appréhension devant ce qui vient, sur la nouvelle venue de l'avenir. La Tech s’impose et, à ce jour, semble bien être capable d’empêcher toute nouvelle appropriation qui ferait émerger une nouvelle façon d'être ensemble au besoin en détournant cette Tech. Au contraire elle s'attaque à l'existence même de ce qui fait notre humanité. Le film n'est pas ici nécessairement pessimiste. Il semble plutôt poser la scène d’une immense bataille en vue. Avec une légèreté, une fragilité et une naïveté qui ne doutent de rien, l’apiculteur Vincent Macaigne que l’on reconnaît bien là, est le général en chef à la manœuvre…
Le contraste avec la vision de Ira Aster est brutal. Lui est d’un pessimisme noir. La bataille est perdue.
Dans son interview pour Le Monde le 19 juillet 2025 : « Je pense que nous vivons tous dans des réalités différentes aujourd’hui. Plus personne n’est d’accord sur ce qui est réel. Et j’ai voulu faire un film sur ce que c’est que de vivre dans un monde où on ne peut plus s’accorder sur le réel, et sur ce qui se passe quand les gens finissent par entrer en conflit. » Le psychanalyste Jacques Lacan aurait dit : “ "Le réel, c'est quand on se cogne." Les physiciens peuvent même contresigner cette définition. Sans problème. Au risque du malentendu dira-t-on. Qu’importe, la rencontre est saisissante. Et la photographie renforçait le lien à un réel unique pour tous, en fait au réel... Pas les réseaux sociaux et les images de synthèse.