Kaisse Hamada, une vocation pour la recherche et le partage
Publié par Elsa Morin, le 17 juillet 2025 690
Kaisse est doctorant en électrochimie à l’Université Grenoble Alpes (UGA), au Laboratoire Électrochimie et Physicochimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI). Il fait partie de l’équipe scientifique de DéfiCO2, un projet de recherche académique interdisciplinaire rassemblant 14 laboratoires grenoblois qui travaillent sur une même thématique : le captage et la transformation du dioxyde de carbone (CO2).
Depuis toujours ou presque, Kaisse sait qu’il veut faire de la recherche. Sa détermination l’a conduit à poursuivre une thèse en électrochimie sur les piles à combustible, son sujet de prédilection. Au travers de son parcours, on comprend la passion de Kaisse pour les sciences de la matière. Mais on y découvre également une autre facette de ce qui l’anime : des valeurs fortes de solidarité et de partage.
- Peux-tu te présenter ?
Je suis Kaisse Hamada, j’ai 26 ans, je suis Franco-Comorien, et je suis actuellement en 2e année de thèse au LEPMI, en électrochimie.
J’ai étudié aux Comores jusqu’au bac, j’y ai obtenu un bac C, qui est l’équivalent du bac scientifique d’ici. Je suis venu en France en 2018 pour étudier en licence de physique-chimie à Evry, dans ce qui est à présent l’université Paris-Saclay. J’ai continué à Orsay pour mon master en sciences des matériaux, toujours avec l’université Paris-Saclay. Et je suis venu à Grenoble pour mon stage de fin d’études, qui a précédé ma thèse.
- Pourquoi avoir choisi de faire une thèse ?
Depuis ma licence, je sais que je veux faire de la recherche. Ça a été très vite clair pour moi, j’ai voulu faire une thèse dès que j’ai commencé à étudier les sciences, surtout après avoir découvert l’électrochimie en licence. Tous mes amis savaient que je ferai une thèse.
J’avais un professeur en licence qui travaillait sur les batteries. Je suis allé me renseigner sur internet sur ce sujet, j’ai trouvé ça bien, la thématique du stockage de l’énergie m’ayant toujours intéressé. J’ai donc cherché très tôt des opportunités dans ce domaine. Pour mon premier stage de master, je n’ai pas réussi à trouver une expérience relative aux batteries ou piles à combustible, car avec le covid les options étaient limitées. J’ai tout de même pu réaliser un stage sur les matériaux luminescents à Centrale Supélec, qui fut intéressant. Mais arrivé en M2 je me suis dit : c’est la dernière année avant de faire une thèse, je veux donc faire un stage qui ressemble à ce que ce j’aimerai étudier en thèse. J’ai vu passer une offre sur l’électrolyse du CO2, je me suis dit c’est pour moi. Il y avait l’aspect matériaux, électrochimie, et aussi l’aspect environnemental avec le CO2, qui m’a également attiré.
Après ce stage, on m’a proposé l’opportunité de continuer en thèse sur le même sujet et j’ai naturellement accepté : cela me plaisait, j’étais déjà acclimaté avec le sujet, mon environnement de travail...
Depuis ma licence, je sais que je veux faire de la recherche. Ça a été très vite clair pour moi, j’ai voulu faire une thèse dès que j’ai commencé à étudier les sciences, surtout après avoir découvert l’électrochimie en licence.
- Comment es-tu encadré et entouré sur cette thèse ?
J’ai les mêmes encadrant·es que pour mon stage de master : Cécile Rossignol, maîtresse de conférence à l’UGA, spécialiste des matériaux, et Nicolas Sergent, maître de conférence à Grenoble INP, spécialiste de la spectroscopie Raman. Les autres personnels du laboratoire m’aident aussi, notamment Laurent Dessemond, professeur à l’IUT Mesures Physiques, et César Steil, responsable de la plateforme Matériaux Électrochimique pour l’Energie (M2E).
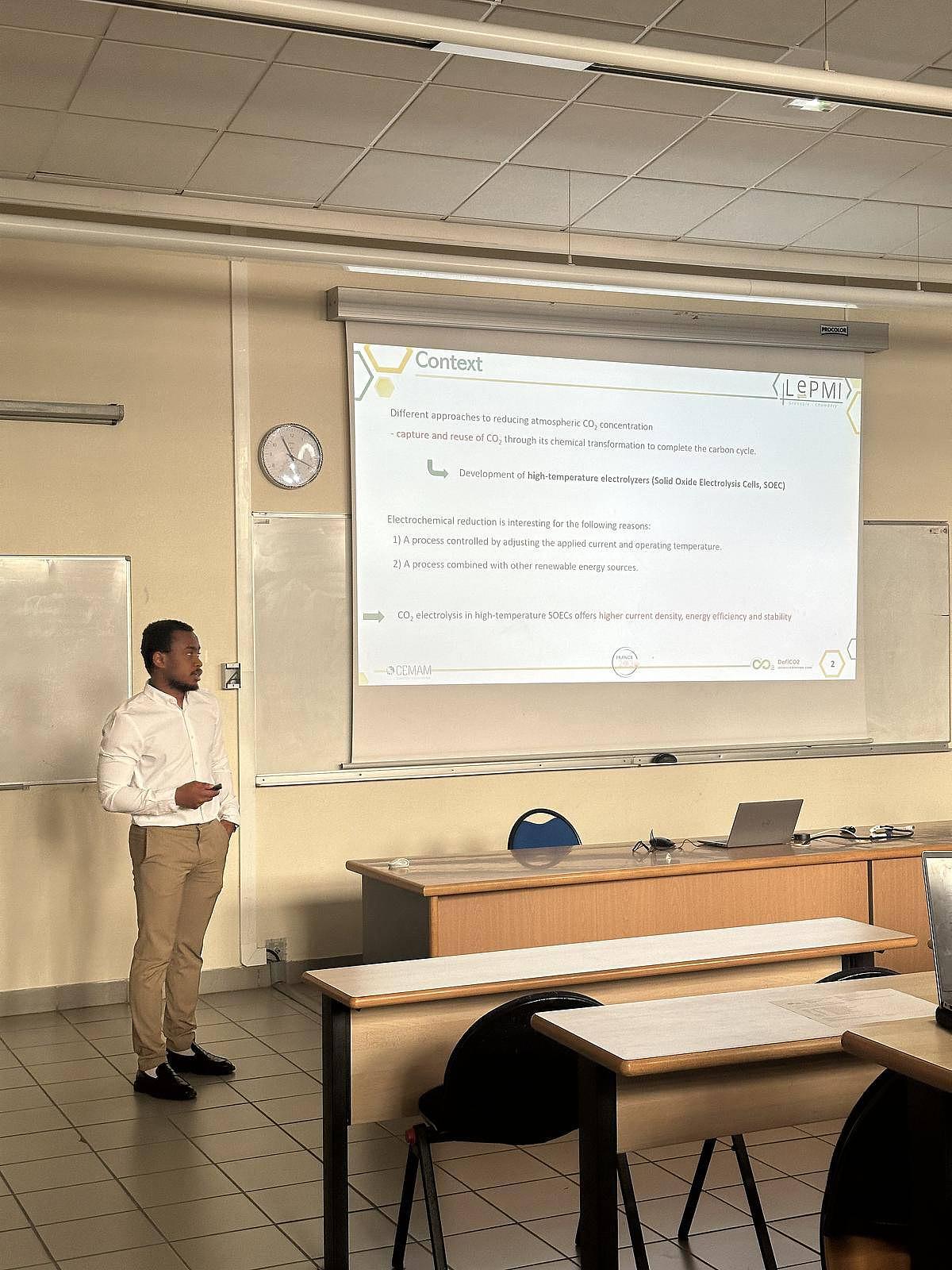
- Quel est ton sujet de thèse ? Quels sont vos objectifs et avez-vous déjà des résultats ?
Le sujet de ma thèse est « l’optimisation de la microstructure de la cathode pour électrolyse du CO2à haute température ». L’objectif est d’utiliser un nouveau matériau cathodique dans les cellules d’électrolyse à oxyde solide pour réduire le CO2 en monoxyde de carbone (CO).
La cathode type utilisée actuellement a des défauts, dus à un dépôt de carbone qui s’accumule au cours du temps sur l’électrode et diminue ainsi la performance et surtout la stabilité.
Dans ma thèse, j’essaye donc de réduire le CO2 avec un autre matériau, à base de pérovskyte (LSF), qui rendrait la réduction moins performante mais plus robuste. Nous avons réalisé des premières études sur le matériau en lui-même, qui décrivent son comportement, ses réactions dans un environnement donné et ses propriétés électrochimiques. C’est la première étape, que nous publierons sous peu. Concernant la réaction de réduction du CO2, nous parvenons à ce jour à catalyser la réaction désirée, mais il nous reste à améliorer le process.
Dans ma thèse, j’essaye de réduire le CO2 avec un autre matériau, à base de pérovskyte (LSF), qui rendrait la réduction moins performante mais plus robuste.
- Que penses-tu du captage du carbone et de son utilisation, thématique commune sur laquelle travaillent les scientifiques de DefiCO2 ?
Je ne travaille pas du tout sur la capture, seulement sur la transformation du CO2. Mais le principe est bon selon moi : on capture et on utilise quelque chose qu’on a déjà émis, ainsi on ne perd pas de matière, on gâche moins (NDLR : le CO2 peut être utilisé comme substitut de matières premières fossiles).
Le réchauffement climatique du au CO2, c’est un sujet qui nous tient à cœur à nous les jeunes, et j’aimerai y contribuer aussi.
Le réchauffement climatique du au CO2, c’est un sujet qui nous tient à cœur à nous les jeunes, et j’aimerai y contribuer aussi.
- Qu’est-ce que travailler sur un tel projet interdisciplinaire t’apporte, selon toi ?
Avant DefiCO2 je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir un lien entre les sciences sociales et les sciences expérimentales. J’ai découvert qu’il y avait des liens possibles, et que d’autres recherches par exemple économiques ou sciences de l’ingénieur ont besoin des données de la recherche expérimentale pour expliquer des choses.
J’ai appris grâce à ce projet que des thématiques pouvaient nous lier, par exemple la taxe carbone. J’étais surpris en écoutant les scientifiques du projet en parler, je ne connaissais pas du tout. C’est très complexe, jusqu’à aujourd’hui je ne saurai pas expliquer comment cela marche exactement.
Avant DefiCO2 je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir un lien entre les sciences sociales et les sciences expérimentales. [...]J’ai appris grâce à ce projet que des thématiques pouvaient nous lier, par exemple la taxe carbone.

- Quels sont tes objectifs à long terme une fois ta thèse terminée ? Comment envisages-tu l’avenir ?
Après mon doctorat j’aimerai faire un post-doc à l’étranger, pourquoi pas au Canada, un pays qui me permettrait de découvrir un autre monde tout en travaillant mon anglais... Et vivre le rêve américain ! (rires)
Ensuite pourquoi pas un autre post-doc en Europe avant de rentrer en France. À terme je souhaite revenir ici, pas trop loin de ma famille, qui habite en région parisienne. Obtenir un poste de maître de conférences à Grenoble serait idéal pour moi, car j’apprécie beaucoup cette ville ! Pas de problèmes de transports en commun, des randonnées en nature accessibles, une bonne vie étudiante...
J’ai également un projet de partage des sciences via l’éducation que j’aimerai réaliser dans le futur. Aux Comores, d’où je viens, l’université est très jeune, donc la science n’est pas si développée. J’aimerai contribuer au développement de la science là-bas, que ce soit en y retournant ou en créant des liens universitaires, des partenariats entre la France et les Comores, comme cela peut se faire avec d’autres pays d’Afrique tels que la Tunisie, le Sénégal...
Aux Comores, d’où je viens, l’université est très jeune, donc la science n’est pas si développée. J’aimerai contribuer au développement de la science là-bas, que ce soit en y retournant ou en créant des liens universitaires, des partenariats entre la France et les Comores.
- Pourquoi aimerais-tu enseigner en plus de faire de la recherche ?
Pendant mes études en région parisienne, j’avais un job étudiant qui consister à donner des cours à domicile. J’ai également participé au « Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) » créé par la CAF pour aider les enfants en difficultés en maisons de quartier à Evry, dans le 91. Les maisons de quartier sont des espaces où les enfants en difficultés chez eux peuvent venir et demander de l’aide pour travailler. J’y ai pris le goût de l’enseignement.
J’ai également eu l’opportunité d’enseigner en licence au DLST cette année, ce qui m’a beaucoup plu.
Les maisons de quartier sont des espaces où les enfants en difficultés chez eux peuvent venir et demander de l’aide pour travailler. J’y ai pris le goût de l’enseignement.
- Qu’est-ce que tu aimes le plus dans la recherche ?
J’aime l’idée de contribuer à l’amélioration de la science dans un domaine précis, et j’aime les valeurs de la recherche académique. Au quotidien, j’apprécie d’être au laboratoire, de designer et monter des expériences.
J’aime l’idée de contribuer à l’amélioration de la science dans un domaine précis, et j’aime les valeurs de la recherche académique.
- Un conseil pour les étudiant·es qui souhaitent s’orienter dans la même voie ?
Foncez ! Mais choisissez votre thèse selon ce qui vous plaît. Il y aura des hauts et des bas, c’est normal, il faut relativiser, tout le monde passe par là. Ce qui m’aide personnellement quand je suis « en bas de la montagne », c’est de penser à mes objectifs futurs.




