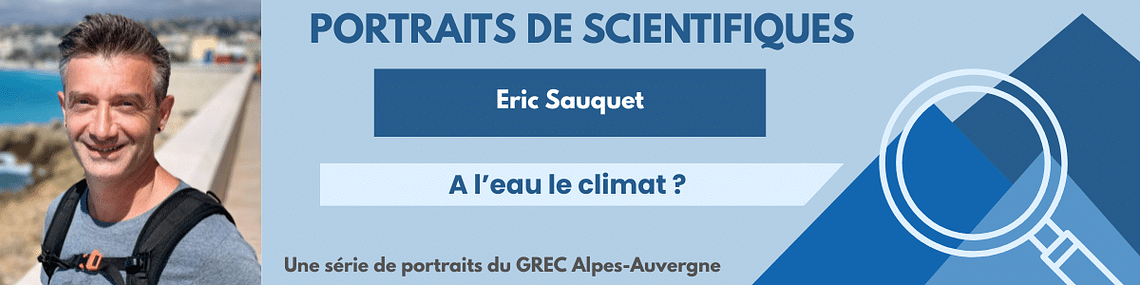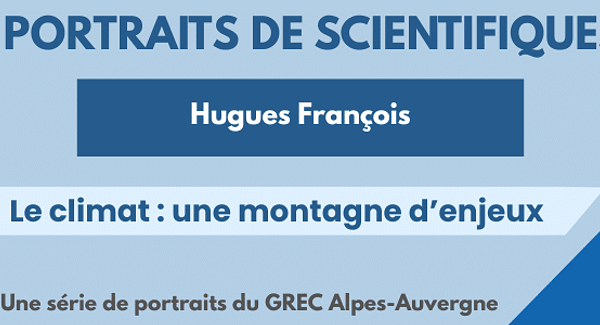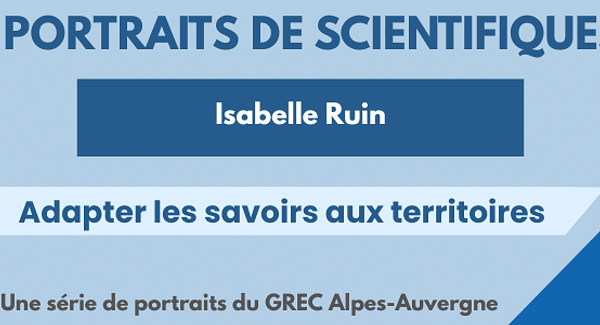Eric Sauquet : à l'eau le climat ?
Publié par GREC Alpes Auvergne, le 25 septembre 2025 1.2k
Eric Sauquet est directeur de recherche en hydrologie à l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) au sein de l’unité Riverly. Il revient ici sur l’importance de la médiation pour rendre accessible les connaissances sur le climat.
Quel est votre domaine de recherche et comment en êtes-vous venu à vous y consacrer ?
Mon parcours m’a progressivement amené à étudier des problématiques diverses liées à l’eau. D’abord orienté vers l'ingénierie environnementale, j’y ai acquis un bagage technique sur les questions de ressources en eau puis j’ai trouvé une appétence pour les questions de recherche lors des stages et de mon service militaire. La recherche appliquée m’attirait particulièrement car elle présentait des finalités opérationnelles. Aujourd’hui mon travail porte notamment sur le cycle de l’eau et, plus spécifiquement, sur les conséquences du changement climatique sur la gestion de l’eau.
Quelles autres dimensions de vos recherches sont liées au climat ?
Certaines de mes missions dépassent le domaine de l’eau car je suis directeur d’un métaprogramme CLIMAE, un programme de recherche interne à INRAE et interdisciplinaire rassemblant des collègues travaillant dans différents domaines autour de la question de l’adaptation de l’agriculture et de la forêt, au changement climatique et de la contribution de ces secteurs à des mesures d’atténuation, c’est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous cherchons des solutions doublement gagnantes en termes d’adaptation et d’atténuation. L’objectif est de mobiliser des leviers divers : la génétique, le changement de régimes alimentaires, …

@INRAE Adeline Dubost
Quelles sont vos actions de médiation ?
J’interviens auprès du grand public au travers d’interventions grand public ou de réponses à des sollicitations de journalistes notamment. Je m'investis également dans des formations universitaires ou d’ingénierie mais aussi auprès des fonctionnaires d’État. Le transfert opérationnel fait aussi partie de mes actions, c’est-à-dire rendre intelligibles les résultats de la recherche pour accompagner les décisions de manière éclairée. Et je mène aussi des actions plus anecdotiques comme la participation à des bandes dessinées ou à du stand up.
Qu’est-ce qui motive votre engagement dans la médiation ?
Il y a à la fois mon rôle en tant que chercheur et mes convictions personnelles. On ne peut pas faire l’un sans l’autre. Face à l’urgence climatique, mon devoir de scientifique est d’alerter et d’aider à la décision, ce qui implique de s’investir dans le transfert de connaissances. Et s'il n’y a pas l’envie de faire de la médiation, elle ne se fera peut-être pas de la bonne manière, il n’y aura pas le même effort pour chercher à communiquer proprement les résultats. La médiation doit rendre l’information accessible afin que chacun puisse s’en saisir, via un dialogue avec l’ensemble de la société. Car les citoyens aussi sont amenés à se mobiliser. Moi-même dans ma vie quotidienne, il y a des choses que je fais et que je ne fais plus.
Qu’est-ce qui peut expliquer le manque de prise en compte des résultats de la recherche sur le climat dans les politiques publiques ?
Pour certains décideurs, il s’agit de leur conviction personnelle (climatosceptiques, complotistes, platistes, …) ou d’un rejet de tout, voire de toute la science. Pour les autres, un des freins inhérents à la thématique est l’incertitude. Les scientifiques ont souvent été prudents face à des résultats incertains avec des modèles qu’on sait perfectibles et une connaissance imparfaite des émissions de gaz à effet de serre. A nous d’être plus engagés ou affirmatifs sans forcément trahir ou survendre des résultats. Car il y a de vrais besoins de compréhension des processus en amont des décisions. Certains collègues produisent de la science pour leurs pairs mais n’ont pas conscience du besoin d’accompagnement. Il ne s’agit pas de mettre uniquement à disposition les données mais d’expliquer comment les utiliser au mieux. D’où la nécessité de développer des services hydro-climatiques adaptés aux besoins.
Comment améliorer la traduction des résultats de la recherche sur le climat en action publique ?
Je pense que la formation fait partie des leviers. D’où mon engagement notamment dans les formations pour les hauts fonctionnaires d’État et dans des interventions tout public. La médiation a également un rôle à jouer en facilitant le transfert des informations vers les décideurs publics. La difficulté est de construire un support de communication efficace. Bien souvent, il faut rattacher les résultats de recherche aux problématiques locales pour rendre le discours plus concret. Des résultats à l’échelle mondiale n’ont pas toujours de résonance avec les défis auxquels le décideur est confronté.
Vous pouvez retrouver les travaux d'Eric Sauquet ici.
Louise Chevallier