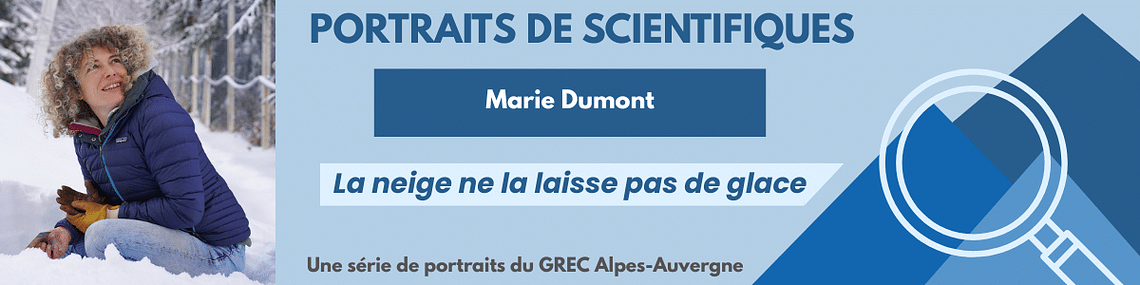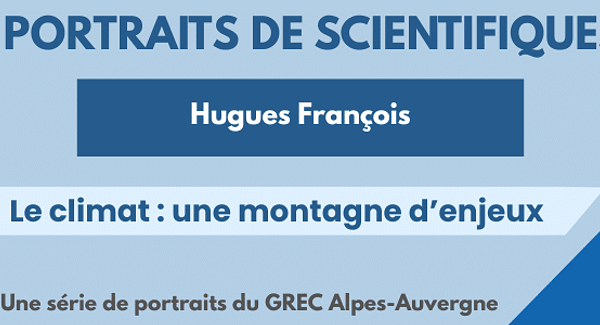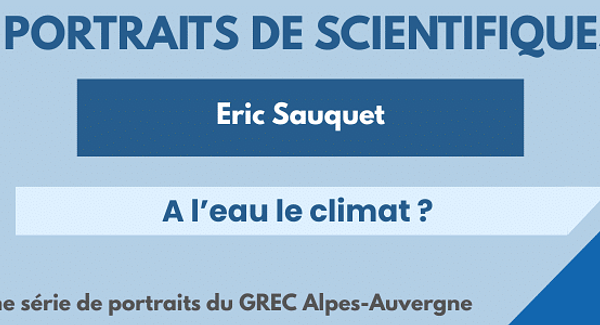Marie Dumont : la neige ne la laisse pas de glace
Publié par GREC Alpes Auvergne, le 15 mai 2025 2.2k
Marie Dumont est directrice du Centre d'étude de la neige (CEN) de Météo-France. Elle étudie la relation entre neige et climat, notamment à travers la couleur de la neige et la modélisation des différents types de manteaux neigeux. Ayant toujours été attirée par la montagne et la neige, elle partage comment elle articule cette passion avec son engagement dans la médiation.
Quel est votre domaine de recherche ?
J’étudie la neige aussi bien à travers des observations que des modélisations du manteau neigeux, afin de comprendre l’impact du climat sur son évolution, et inversement. En effet, la neige, de par sa couleur, influence le climat en limitant l’absorption de l’énergie solaire. Ayant toujours adoré la montagne, lorsque j’ai appris au cours de mes études qu’il y avait un laboratoire qui étudiait la neige, j’ai su que c’était ma voie. J’ai aussi eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m’ont aiguillée jusqu’ici.

Mesures terrain sur la base arctique canadienne de Cambridge Bay dans la base arctique (2024, Lisa Bouvet et Marie Dumont, photo : Yves Lejeune)
Quel sens donnez-vous à vos actions de médiation ?
Être en mesure de maitriser suffisamment un sujet pour le transmettre est très enrichissant. J’aime beaucoup échanger directement avec le public et pouvoir répondre à leur curiosité. Je me sens utile. L’enjeu de la médiation est d’autant plus important que la demande est forte. La cellule de communication de Météo France en partenariat avec un bureau de consulting propose une formation sur la médiation, que nous venons de suivre avec des collègues, ce qui permet de répondre avec plus de facilité aux demandes. De mon côté, mes actions sont diverses, allant d’interviews pour la presse à des conférences-débats comme dernièrement sur les JO d’hiver à l’UGA. J’ai aussi eu l’occasion d’intervenir dans des émissions de France Inter comme Les P’tits bateaux, pour expliquer la couleur du ciel, et La terre au carré, où j’ai abordé l’évolution de la neige face au climat. J’ai également co-écrit le film documentaire « Ma vie de flocon » qui relate une campagne d’étude du manteau neigeux en Arctique. Le rendu est assez poétique, mêlant science et émotion, ce que j’apprécie particulièrement. Il a pu être projeté lors de festivals comme les Rencontres Montagnes et Sciences, touchant ainsi une audience plus large.
Comment favoriser l’appropriation des résultats scientifiques par les citoyens ou les politiques publiques ?
Concernant la neige, il n’y a pas d’autres solutions concrètes pour la préserver que d’arrêter les émissions de gaz à effet de serre. C’est donc le message que je porte. Bien sûr il y a des comportements individuels pour réduire ces émissions et ainsi participer à l’atténuation du changement climatique, mais ce n’est pas mon rôle en tant que scientifique de dire ce que chacun doit faire. Par exemple, l’empreinte carbone du ski est principalement liée au transport. Diffuser cette information peut faire émerger des comportements vertueux privilégiant les mobilités douces pour faire la différence. Mettre à disposition la connaissance permet de générer des actions : c’est sur cette première partie que j’interviens.
Comment s’articulent votre position en tant que scientifique et votre avis en tant que citoyenne ?
Il ne peut pas y avoir le scientifique d’un côté et le citoyen de l’autre, à mon avis. Cependant, j’essaie de m’en tenir aux faits lorsque j’interviens en tant que scientifique, car c’est mon rôle. Mais les deux paroles se croisent nécessairement. D’ailleurs, s’investir dans la médiation scientifique est un acte révélateur. Il traduit une volonté de transmettre l’information, de sensibiliser, d’être utile. C’est ma manière d’agir en tant que scientifique pour ma part. Cela me permet aussi, je crois, de ne pas tomber dans la panique. Je suis très informée et sensible sur certains impacts du réchauffement climatique car je l’étudie, et si en avoir conscience au quotidien peut parfois m’attrister, je ne suis pas anxieuse. La médiation m’aide à ne pas paniquer en mettant en avant que les actions humaines peuvent avoir des effets bénéfiques. Il est important de faire savoir qu’il y a de l’espoir.
Avez-vous une action de médiation qui vous a marqué ?
Je me rappelle d’une conférence, il y a quelques années, sur les couleurs de la neige que j’ai faite à l’occasion de la Fête de la science à Jarrie. Dans la salle, un petit garçon était fasciné et m’assaillait de questions. Il a demandé à sa maîtresse que je vienne refaire la présentation à son école à Saint-Martin-d’Uriage. J’y suis allée et il connaissait tout par cœur ! C’est presque lui qui faisait la conférence. C’était très touchant de voir à quel point une simple action comme celle-ci peut passionner et, peut-être, générer des vocations.

Organisation d’une école d’hiver sur la neige (EGU, OSUG, WSL-SLF, FMI, IACS) (jardin du Lautaret, 2025, photo Mc Kenzie Skiles)
Vous pouvez suivre les travaux de Marie Dumont sur son site.
Louise Chevallier