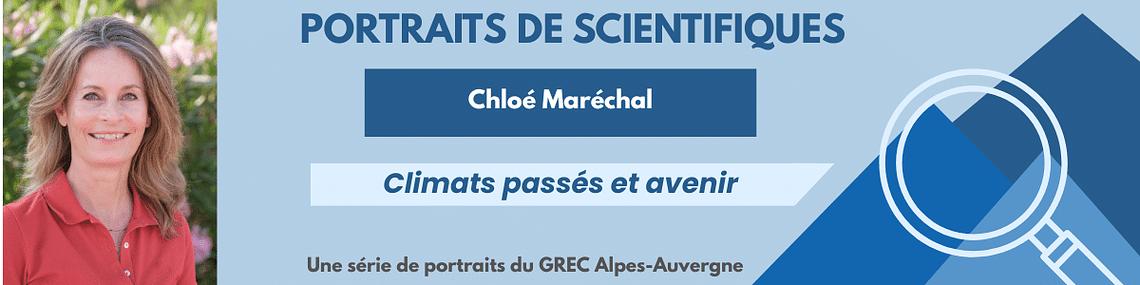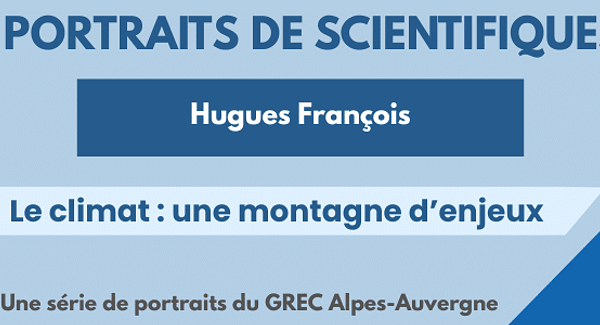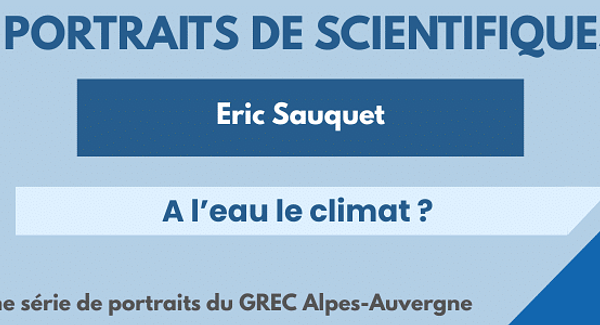Chloé Maréchal : climats passés et avenir
Publié par GREC Alpes Auvergne, le 18 juillet 2025 1.2k
Chloé Maréchal est enseignante-chercheuse en géochimie et paléoclimatologie à l’Université Lyon 1. Elle explique dans cet article comment les fossiles et les carottes de glace nous permettent de remonter le temps pour mieux comprendre le phénomène actuel du changement climatique auquel nous sommes tous confrontés.
Quel est votre domaine de recherche et son lien avec le climat ?
J’étudie la paléoclimatologie c’est-à-dire les climats passés lointains que l’on reconstitue grâce à des outils géochimiques. J’utilise par exemple les isotopes de l’oxygène présents dans les dents de grands herbivores pour reconstituer la température de l’air de leur époque. Je m’intéresse aux alternances climatiques sur les derniers millions d’années, entre les périodes glaciaires et interglaciaires, au cours desquelles le visage de la Terre a complètement changé. Dernièrement, j’ai travaillé sur l’interglaciaire précédant celui dans lequel nous nous trouvons depuis 12 000 ans, l’interglaciaire de l’Éémien, il y a environ 125 000 ans. Cet interglaciaire était un peu plus chaud que le nôtre, ce qui le rend particulièrement intéressant à étudier pour comprendre le climat passé mais aussi pour mettre en perspective le réchauffement actuel, d’origine humaine : son intensité, sa rapidité, ses conséquences sur les glaces, l’océan et surtout la biosphère. Le changement climatique en cours est un évènement inédit de par sa rapidité et son intensité.

Fouille à Caours dans la Somme dans des dépôts de l'Eémien (-125 000 ans)
Qu’est-ce qui vous a amené à étudier les climats passés ?
Durant mes études, j’ai fait l’équivalent d’un stage de master au laboratoire de glaciologie de Grenoble où j’ai étudié une carotte glaciaire du Groenland, c’est-à-dire un échantillonnage de la calotte glaciaire qui contient des couches de plus en plus anciennes à mesure qu'on s'enfonce profondément dans la glace. L’objectif était de mesurer la composition chimique de la glace qui retrace l’atmosphère passée. Il y avait donc déjà cet intérêt pour les climats passés. J’ai également passé une partie de mes études à étudier les processus potentiels de dégazage des lacs artificiels nouvellement créés pour les centrales hydroélectriques du Nord du Canada (Québec). Puis j’ai fait une thèse en géochimie isotopique appliquée à l’océanographie. Après avoir été nommée enseignante-chercheuse, j’ai orienté mon activité de recherche sur les paléoclimats, motivée par l’envie de comprendre comment le système climatique fonctionnait.
Qu’est-ce qui continue de vous passionner dans ce que vous faîtes ?
En prenant conscience du changement climatique anthropique et de ses graves effets sur le vivant (dont l’Homme fait partie), j’ai d’abord été sidérée, puis j’ai eu envie d’agir. J’étais motivée par transmettre ce que j’avais compris à travers mes enseignements et mes sujets de recherche sur les paléoclimats. J’ai notamment participé à la mise en place d’un enseignement sur la transition écologique à l’Université Lyon 1 appelée Climat et Transitions, obligatoire pour tous les étudiants de Sciences et Technologie depuis 2022. J’ai également co-écrit des livres en 2010, 2020 et 2025 et participé à des interventions de vulgarisation scientifique sur le changement climatique et la transition écologique dans l’objectif de diffuser le savoir et faire avancer la société. D’un autre côté, je suis aussi passionnée par mes sujets de recherche. C’est fascinant de voir l’évolution du climat, les capacités extraordinaires de certaines espèces à s’adapter ou au contraire les limites à leur adaptation. Ma curiosité est sans cesse stimulée dans mon métier.

Dent et mandibule de grand herbivore
Quels sont les principaux défis de la médiation sur le climat ?
Il y a un équilibre à trouver pour alerter sans alarmer. Avec l’immobilisme actuel, il ne faut pas sidérer mais plutôt stimuler pour aller de manière collective vers un monde plus enviable. Parfois, entre dire et ne pas dire, c’est compliqué. Il y a aussi l’enjeu de dépasser la distance psychologique qui se crée lorsqu’on parle du climat. Car parler d’une moyenne sur 30 ans est nécessairement abstrait. Ce n’est pas un concept ancré dans un territoire et les échelles de temps sont difficiles à percevoir. Rendre les choses plus territoriales serait un levier pour rendre les enjeux climatiques plus concrets. Lors des amphis-débats organisés dans le cadre de l’enseignement Climat et Transitions, nous faisons intervenir des associations pour montrer ce qui se fait sur le terrain en termes de biodiversité, d'agriculture ou d’alimentation. Ces exemples parlent aux étudiants et permettent de montrer que les choses sont en évolution (naturellement et à travers certaines pratiques), qu’il y a des manières d’agir.
Comment la recherche peut-elle accompagner les transitions sociales et environnementales ?
Le changement climatique étant un problème systémique, il est nécessaire de croiser différents domaines d’études pour l’appréhender. La pluridisciplinarité est essentielle, notamment entre les sciences de la matière et les sciences humaines. La psychologie, l’histoire, la sociologie, l’économie sont autant de facettes à mobiliser pour s’emparer du sujet. Car la lutte contre le changement climatique implique un changement de société important, autant pour limiter le réchauffement que pour s’y adapter, il ne s’agit pas d’un phénomène seulement climatique. Le message scientifique est clair : les humains doivent arrêter d’émettre des gaz à effet de serre dans l’atmosphère à travers leurs activités, dont le principal est le CO2 et provient des combustibles fossiles. Or le modèle de société actuel est basé sur l’extraction de ces combustibles, source principale d’énergie, ce qui remet en question son fonctionnement. Il faut que des choses nouvelles émergent.
Vous pouvez retrouver les travaux de Chloé Maréchal ici.
Louise Chevallier