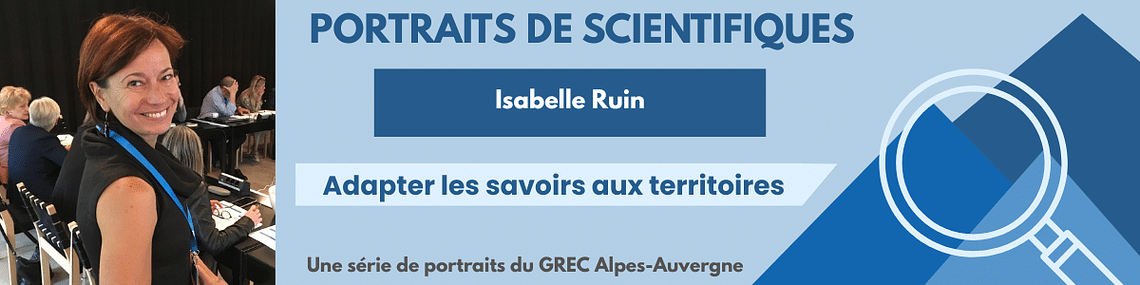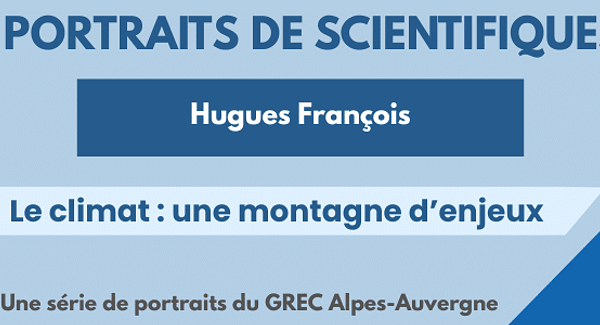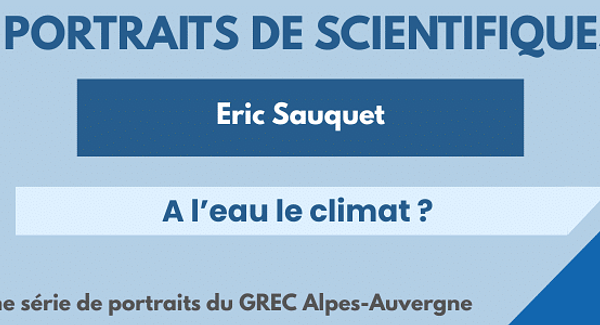Isabelle Ruin : adapter les savoirs aux territoires
Publié par GREC Alpes Auvergne, le 18 septembre 2025 730
Isabelle Ruin est directrice de recherche en géographie sociale à l'Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) où elle travaille sur l’adaptation au changement climatique et membre du comité de pilotage du GREC Alpes-Auvergne. Engagée depuis ses premiers pas professionnels dans la médiation scientifique, elle revient ici sur le rôle que ces actions peuvent jouer dans la lutte climatique mais également sur leurs limites.
Quel parcours vous a amené à travailler sur l’adaptation au changement climatique ?
Après mes études en géologie appliquée (géotechnique), soit l’étude des sols avant construction, que j’ai beaucoup aimées, je ne me retrouvais pas dans les métiers possibles. Je me suis alors tournée vers l’éducation à l’environnement au sein d’un Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). Après ces quatre années où j’ai découvert le milieu associatif, j’ai voulu m’impliquer dans des sujets davantage liés à l'environnement. J’ai travaillé sur les risques naturels au sein d’une autre association, puis, toujours animée par cette envie de lier la physique aux sciences sociales, j’ai repris les études pour travailler sur l’adaptation aux risques. J’ai notamment étudié le comportement et la vulnérabilité des individus face aux crues rapides et aujourd’hui je suis davantage tournée sur l’adaptation des comportements des individus et des sociétés au phénomène global qu’est le changement climatique.
Vos convictions personnelles influencent-elles votre travail et votre engagement dans la médiation ?
Ma sensibilité personnelle m’a effectivement amenée à travailler sur le changement climatique de manière plus large au fil de mon parcours. C’était important pour moi d’aligner mon activité professionnelle avec mes valeurs. C’est aussi dans cet esprit que je me suis engagée dans la médiation. C’est une activité qui me plaît depuis mes premières expériences professionnelles. Je trouve ça valorisant de voir directement l’impact que l’on peut avoir. C’est donc dans une certaine continuité que j’ai rejoint le GREC Alpes Auvergne et que je m’investis dans des initiatives Arts et Sciences ou la création et l’usage de jeux sérieux, notamment dans le cadre du projet à venir kNOW-HOW+4°C (visant le développement et le partage de savoirs et récits socio-climatiques pour opérationnaliser l’adaptation des territoires de montagne à +4°C au sein du projet TRACCS). Et inversement, le fait de travailler en lien avec le climat influence ma vie personnelle où j’essaie d’avoir plus de cohérence entre les connaissances scientifiques et ma vie au quotidien.

@IGE
Quelle importance accordez-vous à la médiation face aux enjeux climatiques ?
Je suis lucide sur le fait que la connaissance ne suffit pas à générer de l’action. Ce n’est pas parce que l’on sait, que l’on fait. Il est nécessaire de changer de comportement et de pratiques quotidiennes. Or c’est très compliqué de changer ses habitudes. La médiation ne peut donc pas se limiter à l’apport de connaissances. Elle doit prendre des formes diverses pour toucher non seulement le cognitif mais aussi les émotions. A mes yeux, la médiation va au-delà du transfert de connaissances, c’est un partage de savoir-faire réciproque. Cet échange est essentiel car tous les acteurs ont à apprendre des autres et c’est en dialoguant que l’on parviendra collectivement à construire quelque chose qui fonctionne.
Comment renforcer le rôle de la médiation envers les décideurs publics ?
Je pense que l’échelle locale est un réel levier pour agir. Là où les décisions nationales ou européennes sont pour beaucoup entravées par la pression de lobbies ou d’intérêts économiques, il y a encore de la marge de manœuvre à l’échelle d’un territoire. Je me suis moi-même impliquée comme élue dans ma commune. Les structures comme le GREC sont essentielles à cette échelle pour comprendre les besoins des décideurs et les accompagner dans la mise en place de politiques locales à la hauteur des enjeux climatiques. Cela répond aussi à un enjeu de justice environnementale que d’accompagner des territoires ou des acteurs qui ont moins facilement accès aux réseaux scientifiques ou qui peinent à faire entendre leurs points de vue. Il est important de favoriser le dialogue entre acteurs et recherche locale car concilier le temps long de la recherche avec le temps court des mandats politiques est assez complexe. Cela implique aussi de renforcer la visibilité des laboratoires de recherche et les moyens accordés pour soutenir ce type d’initiatives afin qu’elles se développent et fassent tâche d’huile plus largement.
Quelle est la place du scientifique dans l’espace public autour des questions climatiques ?
Il faut toujours être clair sur la “casquette” portée lors des prises de paroles et distinguer celle du citoyen et celle du scientifique. Lorsque l’on s’exprime en tant que chercheur, les propos doivent reposer sur des faits rationnels et étayés, sans y mêler de l’opinion. Car en étant partisan, je redoute que la parole scientifique ne soit décrédibilisée et conduise à l’exclusion des discussions. J’ai pu constater dans mon expérience d’élue que pour être entendue, il faut argumenter à partir de la réglementation et des faits, sans mélanger affect et savoir. Bien sûr, nous avons toutes et tous nos convictions personnelles, d’autant plus en travaillant sur le climat, ce qui rend cette séparation difficile à établir. Mais il faut de tout : des scientifiques qui ne sortent pas du cadre de leur statut, et d’autres plus militants pour faire pencher la balance et faire face aux lobbies.
Vous pouvez retrouver les travaux d'Isabelle Ruin ici.
Louise Chevallier