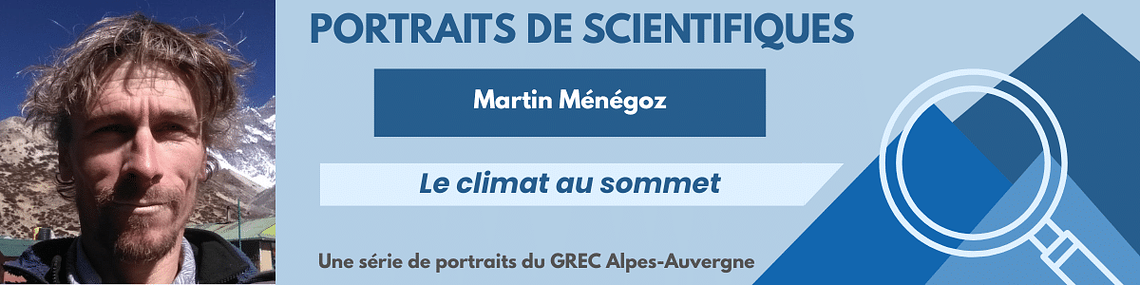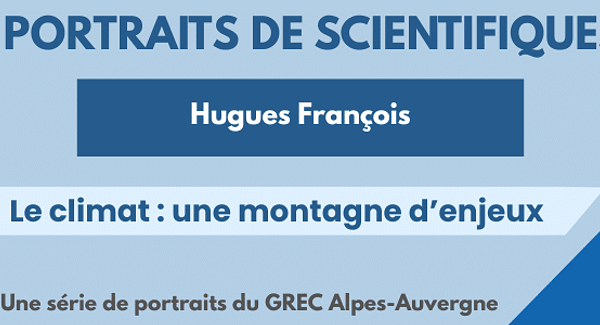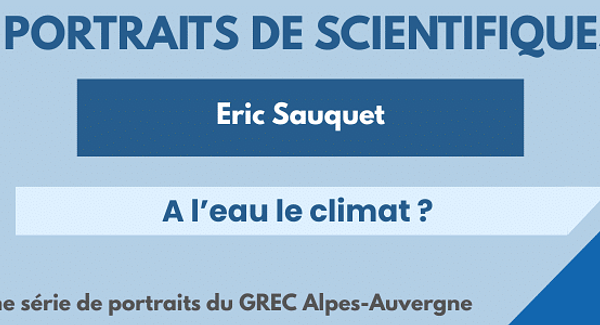Martin Ménégoz : le climat au sommet
Publié par GREC Alpes Auvergne, le 22 mai 2025 1.7k
Martin Ménégoz est chercheur à l’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) sur la variabilité climatique en montagne des siècles passés et futurs. Il partage ici ce qui l’anime et les défis qu’il rencontre dans ses actions de médiation science-société.
Qu’est-ce qui vous passionne dans votre domaine de recherche et qu’est-ce qui vous y a conduit ?
L’étude du climat me passionne. J’essaie de comprendre les causes de la variabilité du climat, aux échelles du globe, régionale et locale, aussi bien sur quelques années, décennies ou siècles. Pour cela, j’utilise la modélisation numérique et l'analyses de données. Je m’implique également dans des campagnes d'observation dans le but de faire le lien entre la variabilité du climat et certaines de ses composantes qu'on observe, comme les glaciers ou la neige par exemple. J'aime particulièrement étudier le climat des montagnes mais ce thème m'intéresse partout, depuis les zones tropicales jusqu’aux pôles. Enfant, j’ai toujours été attiré par ce qui se passait dehors et notamment dans le ciel. J’ai toujours aimé observer les nuages, la pluie, la neige, de manière contemplative. Encore indécis sur ce que je voulais faire à la fin de mes études, mon stage de fin de cursus en master Univers et Environnement de l’Université Grenoble Alpes a été le déclic pour me lancer dans la recherche. Cette activité me permet d’allier mon amour des montagnes avec ma curiosité pour comprendre cet environnement. Avant d’avoir un poste au CNRS, j’ai enchainé plusieurs années de CDD sur divers sujets de recherche liés au climat tout en travaillant comme guide de haute montagne. Aujourd’hui, je travaille exclusivement comme chercheur, mais je continue d’arpenter fréquemment les sommets en dehors de mes activités professionnelles.

@Freepik
Avez-vous une anecdote marquante à partager en lien avec vos recherches ?
Il y a quelques années, on analysait des données de simulations climatiques disponibles sur internet avec des collègues, en vue de publier un article. Les figures étaient prêtes, une idée de titre avait été retenue, il allait être soumis à une revue internationale lorsqu’une autre publication, presque identique, a été publiée au même moment par des chercheurs australiens. Nous n’avions jamais communiqué ensemble, nous ne nous connaissions pas. J’ai alors réalisé à quel point les recherches sur le climat sont internationales et qu’il y a des questions communes à travers le monde. Je trouve ça inspirant. Je n’en retiens pas l’aspect compétitif, que je trouve souvent délétère pour la science, mais au contraire une émulation collective internationale. C’est enrichissant de travailler et d’échanger avec des collègues d’autres régions du monde.
Quelles sont vos actions de médiation science-société et quelle place occupent-elles dans votre travail ?
J’interviens aussi bien dans le cadre académique qu’auprès d’entreprises, d’associations ou de services de l’État. L’objectif est de fournir des éléments sur la variabilité du climat afin que ces acteurs s’approprient ces thèmes. Au-delà des conférences académiques, je pense que les interactions entre scientifiques et acteurs de la société civile sont efficaces pour imprégner les réflexions sociétales du contexte climatique. J’ai eu l’occasion de m’impliquer dans des actions concrètes comme par exemple mon engagement au sein du comité opérationnel de la convention citoyenne pour le climat de la métropole grenobloise, avec d’autres collègues du GREC Alpes Auvergne dont j’ai d’ailleurs été membre du comité de pilotage pendant un an. Aujourd’hui je me fixe des limites sur ces temps d’intervention qui peuvent se révéler très chronophages. Moins je fais de recherche, moins je me sens légitime à transmettre mes connaissances. On constate actuellement une forte demande de médiation de la part de la société mais en revanche pas assez de soutien des acteurs publics, bien que certains territoires comme la métropole soient dynamiques. J’aimerais bien que la communauté d’experts sur le climat s’élargisse, notamment dans la région AURA. Il est essentiel de la faire grandir si on veut répondre correctement à la demande croissante de médiation.
Faut-il envisager la recherche sur le climat de manière davantage opérationnelle pour toucher plus d’acteurs ?
Il y a cinq ans, j’en étais convaincu. Aujourd’hui je suis critique par rapport à cette posture. D’une part, je pense que de nouveaux acteurs opérationnels doivent s’emparer des objectifs de services climatiques, de manière indépendante des laboratoires de recherche, comme les bureaux d’études. Les enjeux sont tels qu’il est essentiel qu’un maximum d’acteurs intègre les questions climatiques dans leurs activités. Le microcosme du monde de la recherche est trop petit pour affronter seul des enjeux aussi majeurs. D’autre part, il aussi est fondamental de garantir une indépendance des systèmes de recherche vis-à-vis des institutions politiques et économiques. Il arrive trop souvent que des recherches climatiques soient sorties de leur contexte pour être finalement dévoyées et servir de caution à des actions néfastes pour le climat. Le terme « services climatiques » lui-même me dérange car, à mes yeux, la recherche sur le climat ne peut pas être directement au service d’une société moderne elle-même engagée dans une spirale infernale qui dérègle le climat. Même le mot « climat » est dévoyé et souvent utilisé comme une vitrine. Par définition, le climat correspond à des variables moyennées sur une trentaine d’années. Lorsqu’on se préoccupe de ce qui va se passer dans l’atmosphère au cours des 15 prochains jours, du prochain hiver ou dans les quelques années à venir, on fait référence à des échelles de temps qui concernent la prévision météorologique ou saisonnière (voire décennale) et non pas celles du climat.

@Freepik
Malheureusement, les agendas politiques actuels sont souvent organisés sur des échéances de court terme, peu compatibles avec une réflexion efficace sur les questions climatiques à long terme. En tant que scientifique, notre rôle est d’informer la société des causes des dérèglements climatiques et d’aider à proposer des solutions afin qu‘elle s’empare sérieusement de la question climatique. L’un des enjeux est de lancer conjointement et avec la même ardeur les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre (atténuation) et celles d’adaptation des sociétés humaines aux nouvelles conditions climatiques, le première étant bien souvent reléguée au second plan. Co-construire des réflexions et des projets associant des acteurs de la société à une multitude de niveaux avec des scientifiques, tout en assurant une indépendance à ces derniers me paraît être une base essentielle pour engager la transition climatique et organiser une société humaine compatible avec le vivant en général.
Vous pouvez retrouver les travaux de Martin Ménégoz sur Google Scholar.
Louise Chevallier