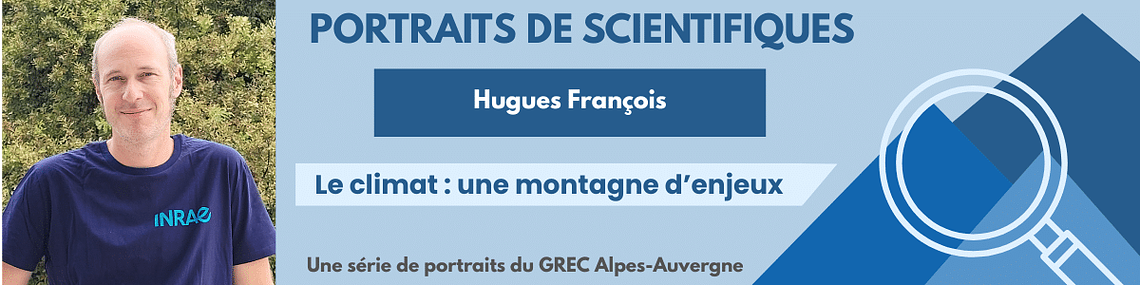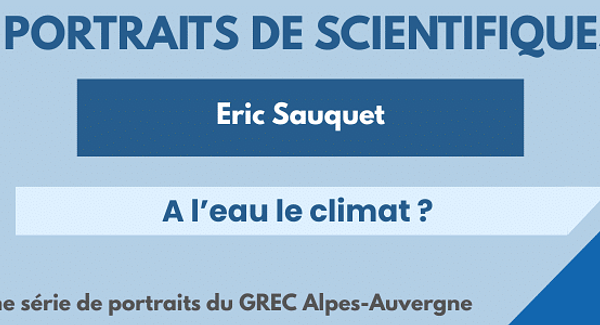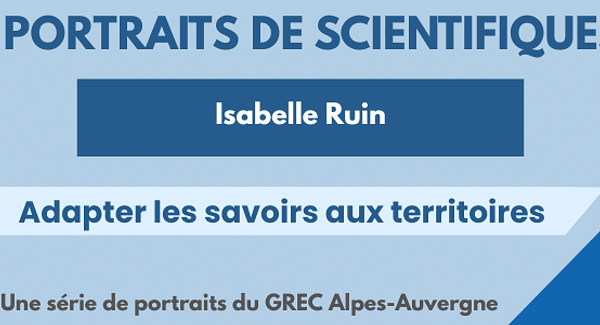Hugues François : le climat, une montagne d'enjeux
Publié par GREC Alpes Auvergne, le 16 octobre 2025 980
Hugues François est ingénieur de recherche à l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE), au Laboratoire des EcoSystèmes et Sociétés En Montagne (LESSEM) et co-anime le Groupe Régional d’Expertise sur le Climat Alpes-Auvergne (GREC AA). Il partage ici comment la médiation lui permet de transformer ses recherches en leviers concrets de dialogue et d’action.
Quel est votre domaine de recherche ?
Je m’intéresse en particulier aux enjeux d’aménagement du territoire et de développement économique en montagne. J’ai travaillé sur le tourisme en zone de montagne, puis plus spécifiquement sur les stations de sports d’hiver, ce qui m’a conduit à intégrer progressivement la question du climat, devenu un axe central de mes recherches. Le modèle socio-économique des territoires supports de stations est mis en tension par le changement climatique. La problématique de leur développement s’est rapidement posée aux acteurs publics et est ainsi devenue un objet de recherche à part entière pour comprendre les effets de l’évolution de l’enneigement sur les conditions d’exploitation des domaines skiables.
Qu’est ce qui continue de vous animer dans votre travail ?
La diversité des travaux au long du parcours de recherche est assez enrichissante. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. J’ai commencé par des travaux plutôt en sciences sociales avec beaucoup d’entretiens auprès des acteurs des stations et aujourd’hui je fais beaucoup de développement informatique et de collectes de données. Je couvre un champ de missions à la journée très varié et en parallèle, je m’investis dans la médiation et la création artistique. Cette diversité permet de maîtriser le processus depuis la production de connaissances jusqu’à sa diffusion, ce qui est très stimulant.
Quelles sont vos actions de médiation ?
Je m’investis beaucoup dans la relation avec les médias et j’utilise aussi les réseaux sociaux pour diffuser les connaissances et toucher le plus grand nombre. J’attache une importance particulière au transfert opérationnel de mes travaux en les rendant accessibles et utilisables par les acteurs locaux. C’est le cas du projet ClimSnow par exemple, sur l’évolution de l’enneigement, issu de nos travaux et porté par un bureau d’études qui joue ce rôle de médiateur auprès du terrain. De manière plus originale, j’organise également des résidences artistiques comme avec le dispositif Tout va bien. Changez rien ! autour des discours de l’inaction climatique.
Quelle est la place de la médiation dans votre activité ?
La médiation donne du sens à mon travail. Il est important pour moi que mes recherches soient utiles et puissent contribuer aux débats sociaux (par exemple, dans le contexte de la fermeture des remontées mécaniques lors de la crise sanitaire du COVID 19 ou pour les JO). Cet enjeu prend une dimension encore plus forte face à la question climatique. La transmission des connaissances est essentielle car je pense que prendre conscience de l’évolution du monde peut générer des actions. On peut vite se sentir démuni face au changement climatique et la médiation permet d’encourager chacun à se saisir de ces enjeux et à se les réapproprier pour agir à son échelle. La difficulté dans cet exercice est de maintenir une frontière nette entre mon engagement personnel et ma posture professionnelle. En tant que scientifique, ma légitimité repose sur la transmission de faits établis, c’est-à-dire publiés et passés au crible de la relecture par les pairs, ainsi que ma capacité à les rendre accessibles au plus grand nombre, sans orienter des choix politiques ou prescrire de solutions. Dès que je sors de ce cadre, je ne parle plus en tant que chercheur mais simplement en tant que citoyen parmi d’autres.
Comment favoriser la prise en compte des résultats de la recherche sur le climat par les politiques ?
L’une des difficultés est que la science établit des constats et fournit des observations, mais n’a pas vocation à inventer des solutions. Ces dernières relèvent de choix politiques fondés sur des valeurs qui dépassent le champ scientifique. En plus d’une certaine ignorance de la part des acteurs publics, les décisions à prendre pour lutter contre le changement climatique sont souvent impopulaires. Elles impliquent des renoncements et, potentiellement ou au moins à court terme, une certaine dégradation des conditions de vie, telles qu’on les conçoit aujourd’hui, à rebours du discours politique traditionnel construit autour du progrès et de l’amélioration. Or, la véritable décision à prendre est de choisir entre subir ou maîtriser la trajectoire climatique. Pour la maîtriser, il faudrait parvenir à réinventer notre vision de l’avenir, en donnant une dimension désirable aux politiques climatiques, de manière à ce qu’elles soient perçues non comme une contrainte mais comme un projet collectif bénéfique.
Vous pouvez retrouver les travaux de Hugues François ici.
Pour aller plus loin :
Articles The Conversation
Vidéo : La fin de la neige naturelle en station ?
Fin de la neige naturelle en station ?
France Inter : Climat et stations de ski : le "snow farming", solution miracle ou impasse ?
France Culture : Le capital neige
Louise Chevallier