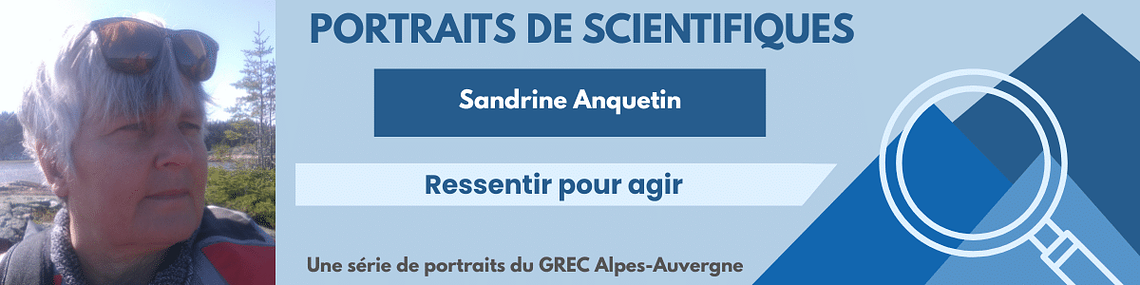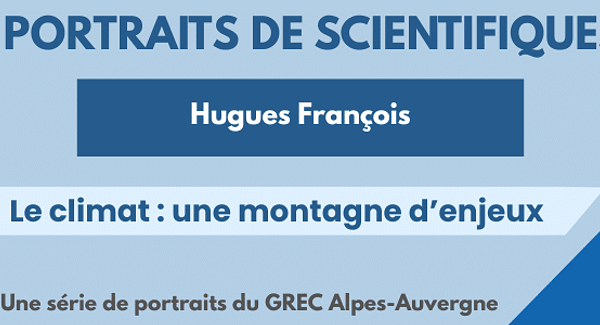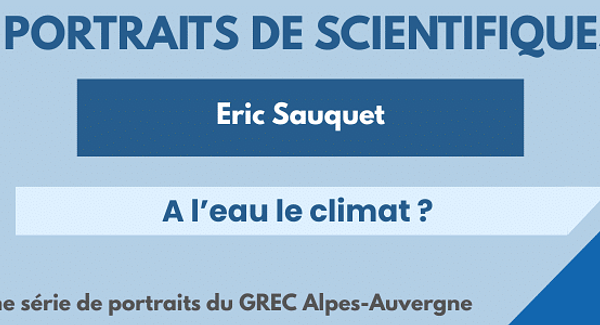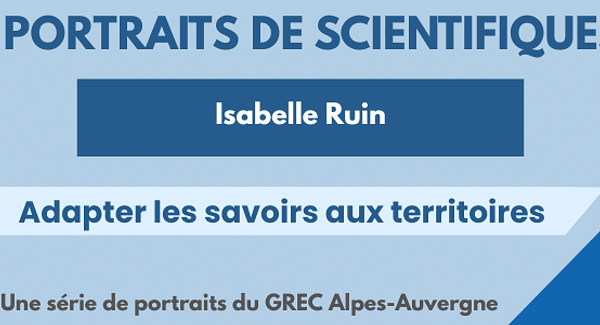Sandrine Anquetin : ressentir pour agir
Publié par GREC Alpes Auvergne, le 9 octobre 2025 830
Sandrine Anquetin est hydroclimatologue à l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) et co-fondatrice avec Céline Lutoff (PACTE) d’Ouranos AuRA, structure Science-Société développée dans le cadre du GIS Envirhonalp précédant le GREC Alpes-Auvergne dont elle est également membre du comité de pilotage. Elle partage ici sa vision de la médiation qui passe autant par les faits que par l’émotion.
En quoi consistent vos recherches en hydroclimatologie ?
Je m’intéresse à l’évolution du cycle de l’eau dans le contexte du changement climatique. J’étudie plus particulièrement la partie continentale, c'est-à-dire les écoulements terrestres et la répartition de la ressource. Il s’agit de situations comme les précipitations, la formation d’inondations et de crues, mais aussi les situations où l’eau est déficitaire, rendant certains territoires difficilement habitables. Mes travaux ont d’abord porté sur les phénomènes extrêmes dans les régions méditerranéennes, notamment les crues rapides, avant de s’orienter vers l’Afrique de l’Ouest autour de l’eau accompagnant la planification énergétique. Dans cette région, seulement 60 % de la population a accès à l’électricité qui est un levier essentiel de lutte contre la pauvreté, pour l’égalité hommes-femmes et d’autres enjeux sociaux, dans un contexte de forte croissance démographique. L’enjeu est d’accompagner l’électrification de la sous-région tout en respectant les accords de Paris, en limitant l’usage des énergies fossiles.

Quelle est la place de la médiation dans votre activité ?
Avec Céline Lutoff (PACTE), j’ai co-fondé Ouranos-AuRA, devenu aujourd’hui le GREC Alpes-Auvergne, avec l’envie de transmettre mes recherches afin que les acteurs de terrain s’en saisissent. J’ai toujours mené une science finalisée, sans doute liée à mon parcours d’ingénieur, qui nourrit cette motivation de traduction concrète. L’une de mes expériences les plus marquantes a d’ailleurs été de recevoir des retours de lecteurs non-académiques sur l’une de mes rares publications en français. Voir mes travaux sortir du cercle scientifique et susciter un dialogue a été très enrichissant. De manière plus classique, j’interviens aussi dans des séminaires grand public ou lors d’événements comme la Fête de la science, que j’apprécie particulièrement pour les échanges directs qu’elle permet avec un public très varié. J’ai également participé à la formation des fonctionnaires d’État. Dans toutes ces démarches, il faut pouvoir s’adapter à l’auditoire, en mobilisant des récits ou des paraboles qui font écho à leur représentation, afin de passer du discours purement rationnel à une dimension plus sensible.
Dans quelle mesure travailler sur le climat influence votre vie personnelle ?
J’ai traversé une période d’éco-anxiété forte que j’ai travaillée à travers le yoga. Je pratique et enseigne aujourd’hui un yoga lié aux saisons qui invite à se reconnecter aux cycles naturels, à ressentir leurs harmonies et leurs déséquilibres. Ancrer ces sensations dans le présent m’a aidé à ne plus être seulement en position d’observateur du dérèglement climatique, mais à trouver une manière de l’intégrer et de le vivre différemment. Dans ma vie quotidienne, je veille aussi à aligner mes pratiques personnelles avec mes convictions, par des gestes classiques comme privilégier le vélo ou ne plus prendre l’avion. J’aimerais aller plus loin en développant une relation plus intime avec la biodiversité qui m’entoure, par exemple en apprenant à reconnaître et nommer les éléments constituants la biosphère (les arbres, les fleurs, etc…). Pour moi, c’est une forme de reconnaissance de leur spécificité et de leur singularité, une manière de retisser des liens avec le vivant.
Quels freins verrouillent l’action climatique selon vous ?
A mes yeux, l’un des principaux freins dans la lutte contre le changement climatique est lié à notre système économique et les valeurs qu’il prône. Tant que la croissance à tout prix restera la norme, il sera difficile de réduire les émissions ou d’adapter nos sociétés au rythme que l’urgence impose. Bien sûr, des initiatives locales existent, notamment à l’échelle des communes, qui permettent d’avancer mais qui restent encore de trop petits pas face à l’accélération des phénomènes climatiques que l’on observe déjà avec la fonte des glaciers, la multiplication des événements extrêmes ou avec le déclin de la biodiversité. A cela s’ajoute un frein culturel. Depuis des décennies, notre société entretient l’idée que tout changement de mode de vie équivaut à une perte ou à un renoncement. C’est pourquoi les citoyens craignent ce changement, qu’ils perçoivent comme quelque chose de négatif. L’enjeu est de réinventer notre manière de faire société, car aujourd’hui on ne vit pas ensemble, mais les uns à côté des autres (voire parfois contre les autres).

Quel est le rôle du scientifique ou de la médiation dans la lutte contre le changement climatique ?
En tant que parties prenantes d’une société, les scientifiques ont la responsabilité de communiquer avec elle. A l’heure des fake news et de la désinformation, il est d’autant plus crucial de faire entendre la parole scientifique dans l’espace public. Mais ce partage des connaissances doit se faire autrement, en dépassant le discours anxiogène car il paralyse. Je pense que la médiation doit ouvrir d’autres voies et s’adresser aux sensibilités, pas seulement à la raison. Car savoir ne rime pas avec agir. En faisant appel aux émotions, qu’elles soient positives ou négatives, on peut générer de l’action en invitant les individus à repenser leur représentation du bonheur, qui serait davantage fondée sur une forme de simplicité et liens sociaux retrouvés. C’est en faisant résonner les savoirs avec l’expérience sensible des individus que l’on peut créer du mouvement, un élan collectif, là où l’anxiété tend à isoler et à figer.
Vous pouvez retrouver les travaux de Sandrine Anquetin ici.
Louise Chevallier