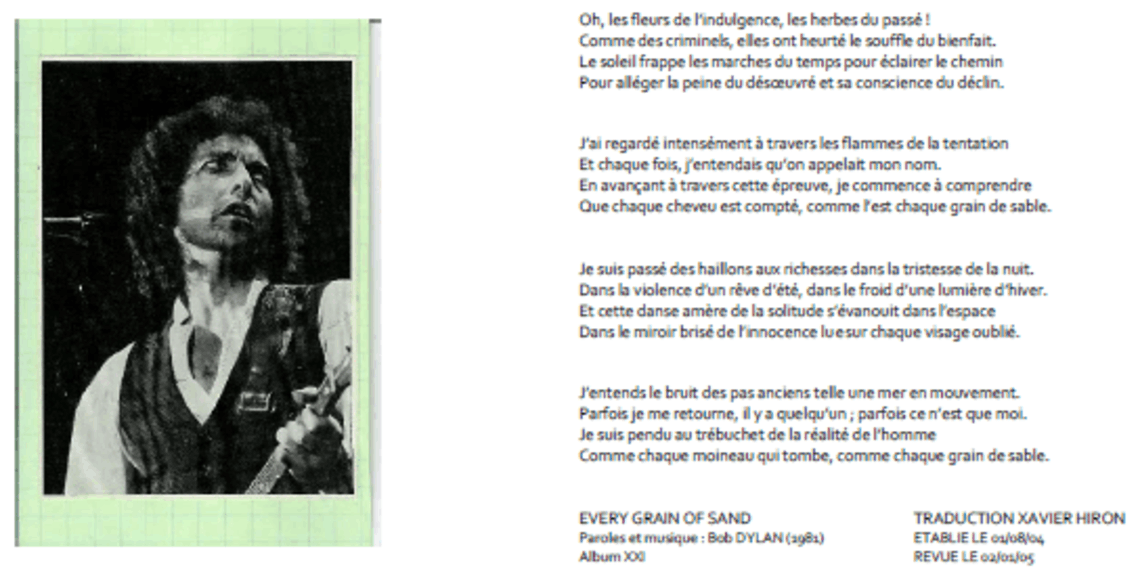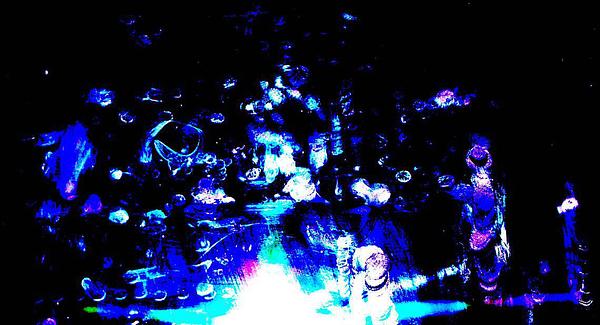POUR UNE ESQUISSE DE BOB DYLAN : spécificité littéraire de l’œuvre chantée 2/2
Publié par Xavier Hiron, le 17 juin 2021 2.5k
Suite et fin du texte présentant les caractéristiques littéraires de l’œuvre de Bob Dylan (voir ici le lien vers la première partie).
DU FESTIN NAÎT LA CROYANCE
De ce qui précède, nous retiendrons seulement que Bob Dylan s’enracine délibérément dans la tradition. C’est pour cette raison même, il me semble, qu’il faut commencer la traduction des œuvres chantées de Bob Dylan non pas par sa première livraison personnelle, c’est-à-dire la première chanson intégralement signée de sa main, parole et musique, mais bien dès son premier album, presque exclusivement composé de morceaux anciens, de reprises et de réarrangements de standards oubliés. D’emblée, ces chansons semblent le reflet de ce qu’il souhaite (plus ou moins confusément, certes) véhiculer. En témoigne, s’il en était besoin, le titre emblématique House of the rising sun qui n’obtint la postérité qu’on lui connaît désormais que grâce à la restructuration musicale qu’en a fait connaître Dylan lui-même, même si l’on sait aujourd’hui que la transcription des accords qui a insufflé une seconde jeunesse à ce tube ignoré a été « empruntée » par Dylan à l’un de ses condisciples, le musicien new-yorkais Dave van Ronk.
LA MAISON DU SOLEIL LEVANT (1960)
Il est une maison dans la Nouvelle Orléans
Qu’on appelle le Soleil Levant.
Elle a causé la ruine de plus d’une pauvre fille
Et moi, oh mon Dieu, je suis l’une d’entre elles.
Ma mère était une couturière.
Elle m’a cousu ce nouveau blue-jean.
Mon doux amour était un joueur, Seigneur !
Un joueur dans la Nouvelle Orléans.
La seule chose dont un joueur a besoin
C’est d’une valise et d’une malle.
Et les seuls moments où il se sent bien
C’est quand il a bu un coup de trop.
Il remplit ses verres à ras bord
Et il distribuera les cartes.
Le seul plaisir qu’il tire de la vie
C’est de voyager d’une ville à l’autre.
Oh, dites à ma petite sœur
De ne pas faire ce que j’ai fait.
Mais de fuir cette maison de la Nouvelle Orléans
Qu’on appelle le Soleil Levant.
Car c’est un pied sur le quai
Et l’autre sur le marchepied
Que je m’en retourne vers la Nouvelle Orléans
Pour porter ma chaîne et mon boulet.
Je m’en retourne vers la Nouvelle Orléans.
Ma descendance s’est presque évanouie.
Je m’en retourne terminer ma vie
Dans la maison du Soleil Levant.
Il est une maison dans la Nouvelle Orléans
Qu’on appelle le Soleil Levant.
Elle a causé la ruine de plus d’une pauvre fille
Et moi, oh mon Dieu, je suis l’une d’entre elles.
HOUSE OF THE RISING SUN TRADUCTION XAVIER HIRON
Paroles et musique : traditionnel, arr. Dave Van Ronk (1960) ÉTABLIE LE 02/10/04
Album I DÉFINITIF LE 02/10/05 (+EB)
REVU 2006 et 2009
À l’instar de ces reprises, les premiers textes de Dylan atteignent parfois des accents de fraîcheur et de véracité que l’on observait déjà en prémisse - cet élément a forgé le creuset de leur fabuleuse destinée - dans les blues ancestraux, tels que les a rassemblés et traduits, à peu près à la même époque où s’élaborait l’œuvre de Bob Dylan, notre académicienne Marguerite Yourcenar [3]. Là encore, par la musique et par les thèmes abordés, on se situe dans le courant de la continuité qui fait corps, quoi qu’on en dise, avec l’œuvre de Bob Dylan. Et par ailleurs - et cela est loin de constituer un détail négligeable pour ce qui concerne la perception que l’on nourrie de la personnalité de Bob Dylan -, ces morceaux anciens, dans lesquels il n’aura de cesse de puiser allègrement, ont le mérite de poser d’entrée de jeu la question de la pertinence du fait religieux dans l’esprit de Dylan. En d’autres termes, ce fait religieux n’est-il, pour le Dylan des origines, qu’un matériau comme un autre issu de cette tradition musicale qu’il entend creuser ? Et si oui, à partir de quand et sur la base de quels éléments le questionnement religieux deviendra-t-il une obsession existentielle pour le Dylan de la maturité ? Certes, un tel sujet dépasse de beaucoup le cadre de notre présentation, mais la question ainsi posée resterait indubitablement à élucider.
Mais là où la notion de continuité rejoint le génie qui habite Bob Dylan c’est qu’elle n’est pas, chez ce dernier, qu’un simple fondement. Elle ne constitue pas qu’un vulgaire tremplin pour une expérimentation d’expression nouvelle et exacerbée. Avec Bob Dylan, la continuité ne se suffit pas à elle-même. Elle ne se suffit pas d’un simple renouvellement d’elle-même, sorte de naïf dépoussiérage comme on en a tant vu depuis cette époque charnière des années 1960, mais elle devient délibérément englobante et universaliste, d’une manière qu’on pourrait presque qualifier - toutes proportions gardées - de « totalitariste ». En tout état de cause, elle n’accepte aucune concession vis-à-vis d’elle-même. Et par voie de conséquence, vis-à-vis du monde tumultueux qui l’entoure… Elle ne devient qu’un élément de la formidable entreprise de recréation qui est en marche d’un nouvel art autonome et qui atteindra, en quelques enjambées seulement, sa propre plénitude. Que l’on songe seulement à l’énorme distance intergalactique qui sépare les reprises, pourtant déjà si abouties, de Lili of the West ou de Pretty Peggy-O et un texte absolument somptueux et à la puissance poétique improbable, comme jailli de nulle part, tel que A hard rain’s a-gonna fall. En l’espace de deux albums, c’est-à-dire en moins d’un an seulement, des années lumières semblent s’être écoulées.
Et il en sera de même entre le festival folk de Newport de 1963 et celui, tragique dans les faits mais ô combien salvateur dans l’esprit, de 1965. Il semble que l’on soit passé subitement d’une ère à une autre ère, alors que rien, absolument rien ne nous y préparait. Une explosion venue d’on ne sait où, au point que ses coreligionnaires, rendus fous en coulisses par ses hardiesses musicales, se seraient mis à crier « apportez une hache, qu’on sectionne ces câbles électriques ! » Et Dylan ne s’arrêtera pas là. De roulements de tonnerres en zébrures d’éclairs, les coups de génie s’enchaînent : car viendra exactement dans le même temps - pour honorer cette participation quasi improvisée au festival de Newport 1965, Bob Dylan venait de quitter la session d’enregistrement de l’album Highway 61 revisited - l’intuition géniale de Like a rolling stone, aidée il est vrai en cela par un petit coup de pouce du destin (mais le destin ne frappe jamais à la porte par hasard, nous rétorquerait celui dont la version rimée originale était formée de 45 couplets !). Car le compositeur, ainsi que ceux qui l’entourent - dans son génie résolument novateur, Bob Dylan devient un véritable agent catalyseur de la création contemporaine autant qu’un formidable meneur d’hommes -, a tout créé de la musique nord américaine de la seconde moitié du XXe siècle. En premier lieu, il fonde de manière définitive le style Rock and folk, comme l’expression ultime - et incomprise à la fois - de la modernité américaine : logorrhée jugée bruyante et tapageuse d’une société qui trouvera insupportable d’y reconnaître ses propres contractions d’aspiration au progrès galopant et au dynamisme forcené.
Non, Dylan ne s’arrêtera pas là. Car c’est en réalité tout un nouvel univers qu’il veut créer et auquel, de facto, il va réussir à donner forme et vie. Car il réinvente - lui et ses producteurs, on ne le démêlera jamais tout à fait - toute la musique pop-rock américaine. Il crée d’abord et avant tout la profusion dans la création, base incontournable de tout ce qui en découlera. Il crée ensuite l’expressionnisme musical dans des concerts électrisés. La tentative de saturation du son restitué. Il crée le réinvestissement des lieux symboliques au profit de l’expression créatrice. Le premier véritable clip, quelque part, lové au coin d’une rue de New York. Mais aussi, la réappropriation de stades colossaux pour des concerts monstres, sortes de grand’ messes populaires et semi-mystiques à la fois, là où les prestations stridentes des Beatles - autres géants s’il en fut - nous apparaissent désormais comme de pâles communions de transe et d’hystérie juvénile. Il crée la commercialisation à outrance ; mais aussi, le concept augmenté du double album. Il crée les méga-tournées planétaires, l’omniprésence sur les ondes, la saturation médiatique et l’art de contre-pied et de la dérobade journalistique. Car Dylan, en grand créateur qui se respecte, ne se trouve jamais là où on l’attend, intellectuellement parlant. Le ressort de la surprise et de l’inattendu est inhérent à son art. Le besoin systématique de provoquer des émotions nouvelles et inconnues est érigé, avec lui, en véritable dogme. En découle une suite ininterrompue d’électrochocs permanents, telle une immense thérapie de groupe inondée en continue sur les ondes et dans les sillons : une démonstration par l’exemple de ce que doit être, selon Dylan, une authentique culture vivante.
LARMES DE RAGE (1968)
Nous t’avons portée dans nos bras
Au Jour de l’Indépendance.
Et maintenant, nous pousserais-tu de coté
Et nous jetterais-tu dehors ?
Oh, quelle chère fille sur la terre
Voudrait traiter ainsi son père ?
L’attendre de pied ferme
Et toujours lui dire : « Non » ?
Larmes de rage, larmes de douleur :
Pourquoi dois-je toujours être le voleur ?
Viens vers moi, tu sais
Combien nous sommes seuls
Et que la vie est courte.
Nous t’avons montré la voie
Et écrit ton nom sur le sable
Bien que tu aies pensé que ce n’était
Rien qu’un endroit où rester.
Je veux que tu saches que quand on te regardait
Découvrir que personne n’est sincère
La plupart des gens pensaient
Que tu agissais comme une enfant capricieuse.
Larmes de rage, larmes de douleur :
Pourquoi dois-je toujours être le voleur ?
Viens vers moi, tu sais
Combien nous sommes seuls
Et que la vie est courte.
Nous n’avons pas eu de peine
Quand tu es partie recevoir
Toute cette instruction trompeuse
À laquelle nous ne croirons jamais.
Et voilà que ton cœur s’est rempli d’or
Comme si c’était une bourse.
Oh, mais quel est donc cet amour
Qui va de mal en pis ?
Larmes de rage, larmes de douleur :
Pourquoi dois-je toujours être le voleur ?
Viens vers moi, tu sais
Combien nous sommes seuls
Et que la vie est courte.
TEARS OF RAGE TRADUCTION XAVIER HIRON
Paroles et musique : Bob DYLAN ÉTABLIE LE 28/03/13
Album XV REVU LE 23/06/2013
Lien vers une vidéo d’époque sur youtube
Car ce qui est et reste primordial, par-dessus tout, c’est que Dylan ne mésestimera jamais ni ne tournera le dos, bien au contraire, au fait social dont il se considère issu, ni ne s’éloignera du parti de l’homme dont il porte les valeurs. Et plus particulièrement, de cette jeune génération à laquelle il appartient et dont il deviendra, mais à son corps défendant - puisque son propos, comme on l’aura compris, est délibérément ailleurs -, un des porte-parole. Bien au contraire, il se fond dedans, tel un poisson dans l’eau. Il se laisse porter, semble s’en griser jusqu’à saturation, tout en restant toujours maître de sa fougue, de sa verve, de ses orientations musicales : bref, de son art. Il semble parfois qu’emporté par son élan, dans cette exaltation fondamentale qui le caractérise, Bob Dylan ne sache plus très bien discerner où se situent les limites. Mais peu importe s’il transgresse les frontières, car seul compte pour lui le fait que ce qu’il porte s’accomplisse, que ce qui est porté à travers lui accomplisse sa propre révolution, quels que puissent en être les effets, d’ailleurs. Car l’art, chez Dylan, ne se contente pas d’approximations.
L’AILLEURS, OU LA VÉRITÉ QUI BRISE
Mais resterait alors une question qui taraude l’esprit du commun des mortels : quel est donc le secret de ce grand ensorceleur ? Où résideraient son charme mystérieux et son terrible maléfice ? Dans la facilité de sa parole ? Dans cette fluidité de l’air qu’il véhicule ? Dans cette souplesse insolente de jeune premier ? Dans la justesse impitoyable de son ton - s’il lui est arrivé, parfois, parmi l’immensité des livraisons musicales et parolières qu’il nous offrit, de se tromper de cible, Bob Dylan, cependant, ne chante jamais faux ni sans conviction - ? Dans la vitalité de sa respiration musicale ou dans cette fraîcheur effrayante de son esprit ? Dans son agilité envoûtante d’araignée ou dans la mobilité quasi hypnotique de ses textes, que véhicule pourtant une voix éraillée « de canard [4] », tout emprunte d’attraits charmeurs autant que de répulsions mêlées ?
Tout cela, dans sa globalité, certes, participe de la magique attraction que diffuse le génie créateur de Bob Dylan. Tout cela y contribue tout à fait violemment. Mais ce qui surpasse tout le reste et sans quoi rien d’autre n’aurait pu exister pleinement, n’aurait pu totalement advenir dans cette concrétisation au cœur du monde sensible, c’est cette osmose parfaitement naturelle d’une inimitable poétique moderne soutenue par un don inégalable de mélodiste. Chez Dylan, tout, texte et musique confondus, se résume à une mélodie insurpassable. Tout son être est en permanence tendu vers ce but unique, ce Graal qu’il se doit de renouveler à chaque instant que sa respiration se met en mouvement : trouver de l’harmonie mélodieuse et indissoluble entre la pensée que véhiculent les mots dont son esprit s’empare et son accomplissement dans le réel de la musique.
Cette manière inimitable de faire coller le verbe et la note, quel que soit le prix à payer pour parvenir à la trituration de l’un afin d’assouvir l’autre, quelle que soit la dette contractée pour obtenir la soumission de l’autre envers le premier, est le secret essentiel de son admirable alchimie. Et combien de fois, en remettant son ouvrage sur le métier, Bob Dylan eut-il à défendre tout cela avec fougue, morgue, vigueur et une inépuisable conviction ? Car c’est bien cet alliage sans cesse reforgé, tout autant que l’admirable volonté dépensée à le défendre, à en légitimer l’existence, qui furent, en fin de compte, ses armes uniques de vivant, ses seuls atouts de créateur, ses pauvres moyens d’homme aux mains nues, lui pour qui tout restait toujours à la fois acquis et en même temps à reconstruire.
Car comment ne pas prendre la véritable mesure de ce qui sépare les chansons de Bob Dylan, en tant qu’artiste visionnaire, de leur fabuleux potentiel de perfection mélodique qu’elles portent en elles lorsqu’on se prend à écouter, par exemple, les nombreuses et merveilleuses interprétations qu’a pu en fournir, au fil du temps, Joan Baez [5], sa muse des origines, elle qui sut continuer à promouvoir cette œuvre magnifique année après année, et cela bien longtemps après avoir eu à ravaler les déboires de leur orageuse séparation ?
Ici réside, semble-t-il, cette part inatteignable de Bob Dylan artiste, et qui le rend incomparablement humain : la part cachée de son incomplétude. Cette part grandiose et sublime à la fois, qui fonde son involontaire destin, lequel se logerait dans cette immense vacuité de l’infinité de son art. Car le secret que nous apporte Bob Dylan créateur est qu’il n’existe qu’un seul art, unique et indissoluble, mais qui reste à tout jamais inabouti. En quelque sorte, l’art est une perfection qui resterait, et pour toujours, profondément inachevée. Et tout le reste - quoi qu’on ait pu dire ou qu’on dira encore au sujet de Bob Dylan : paroles sensées ou insensées, choses fondées ou infondées - n’a eu ni n’aura jamais, en regard de cette révélation existentielle qu’il eut à vivre comme un calvaire parfois, une profonde cicatrice faite à son âme à tout le moins (car le terme de « révélation » est ici à prendre dans le sens : qui touche à l’existence même de l’individu), aucune espèce de conséquence sur l’être qu’il fut et tente de rester encore. Aussi, fort de cet enseignement diffus que nous transmettent, en échos lointains, les chansons de Bob Dylan, notre unique devoir - celui que nous aurons appris d’un artiste confronté à la réalisation dans le concret du réel de son œuvre qui, pourtant, reste toujours comme en suspend - n’est-il rien d’autre, finalement, que de chercher à prolonger humblement ce qui est advenu un jour au monde, et ce quel qu’en fut le trajet, obscur ou lumineux, de sa révélation ?
Notes :
[3] Fleuve profond, sombre rivière, les negro spirituals, commentaires et traduction, Marguerite Yourcenar, NRF Poésie n° 99, Gallimard, 1966.
[4] l’expression est de mon second fils et n’est malheureusement pas dénuée d’une certaine véracité, car Dylan eut à souffrir de tant de critiques sur le timbre nasillard de sa voix.
[5] à écouter : le double album Any day now (ouvrir puis laisser défiler) compilation de toutes les reprises studios des chansons écrites par Bob Dylan et chantées par Joan Baez avant 1975, contenant entre autre l’hallucinante version a capella du titre Tears of rage cité plus haut, laquelle démontrerait à elle seule toute l’étendue du potentiel mélodique de l’œuvre de Bob Dylan. D’autant que le texte de cette chanson constitue l’une des illuminations à la qualité quasi-hypnotique dont seul Dylan a le secret.
En guise de final, citons le texte tout aussi éclairant et sublime de la chanson de Joan Baez Diamond and rust, qui semble avoir été écrite pour solder le compte sentimental qui subsistait entre les deux protagonistes. Dans les faits, elle constitue une réponse de fin de non recevoir au texte If You See Her, Say Hello que Dylan a inséré dans son quinzième album, enregistré entre septembre et décembre 1974, où s’exprime une certaine nostalgie. En la circonstance, Dylan lui a offert l’occasion de signer l’une de ses plus magnifiques chansons.
JOIE ET AMERTUME* – Joan Baez
Je vais être damnée
Car revoici ton fantôme.
Mais ça n’a rien d’inhabituel.
Ce n’est que la pleine lune
Et qu’il t’arrive d’appeler.
Alors je m’assoie
La main tenant le combiné.
Écoutant une voix qui me revient
De deux années lumière au moins
Et se dirige vers un naufrage.
Tes yeux, autant que je m’en souvienne
Étaient plus bleus que les œufs d’un rouge-gorge.
Ma poésie était indigente, disais-tu…
D’où appelles-tu ?
D’un coin paumé du Midwest.
Il y a dix ans de cela
Je t’ai acheté des boutons de manchette.
Toi, tu m’as amené quelque chose.
Mais nous savons tous les deux que les souvenirs
Ramènent autant de joie que d’amertume.
Toi, tu brûlais sur la scène
À devenir une légende
Un phénomène inaltérable.
Toi, l’authentique vagabond
Tu t’es fondu dans mes bras
Et tu y es resté
Momentanément perdu en mer.
La Madone s’était offerte à toi.
Oui, cette fille juchée sur sa conque
T’aurait protégé de tout.
Maintenant, je te vois te dresser
Au milieu des feuilles qui tombent
De la neige dans les cheveux.
Maintenant, tu souris derrière la fenêtre
De cet hôtel minable
Derrière Washington Square.
Les nuages blancs de notre respiration
Se confondent, suspendus dans l’air
M’évoquant cette cruelle évidence :
Chacun de nous aurait pu mourir en chemin...
Alors tu me dis
Que tu n’es pas nostalgique.
Donnes-moi donc un autre mot pour évoquer cela
Toi qui manies si bien les mots
Et sais garder les choses floues.
Et puisque tu m’as appris l’incertitude
Il me revient très clairement
À quel point je t’ai aimé passionnément.
Aussi, si tu me ramènes de la joie et de l’amertume
Sache que j’ai déjà payé.
DIAMONDS AND RUST TRADUCTION XAVIER HIRON
Paroles et musique : Joan Baez (1975) ÉTABLIE LE 28/01/2014
Album Diamonds and Rust REVU LE 30/01/2014
Lien vers une vidéo d’époque sur Youtube :
(en léger retrait ci-dessus, ce qu'on appelle un pont musical)