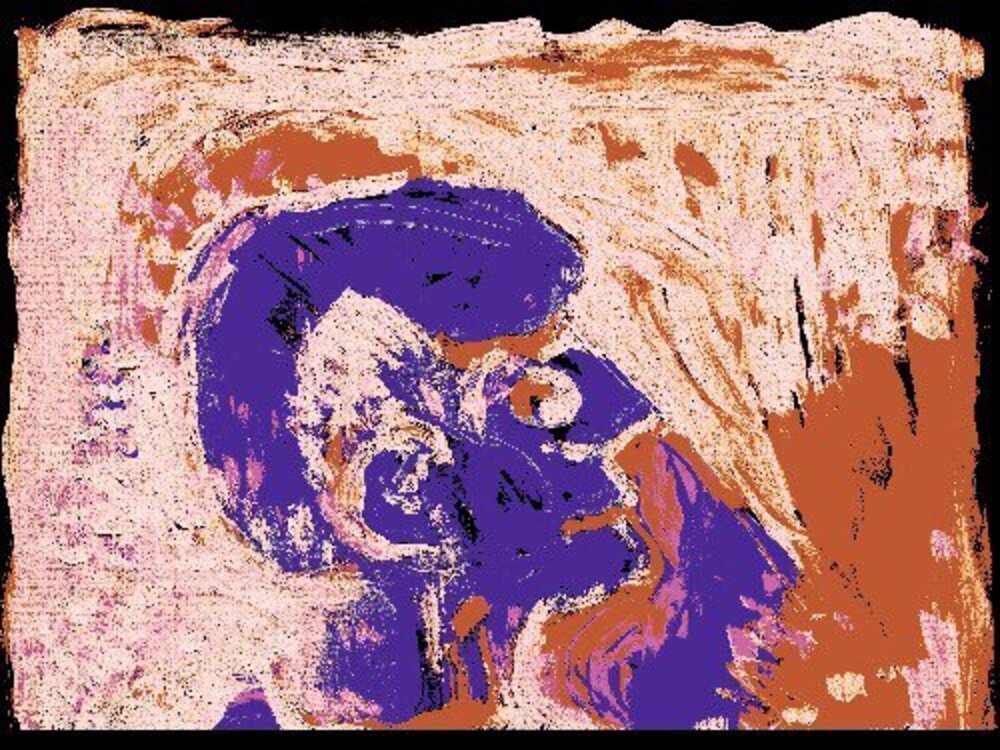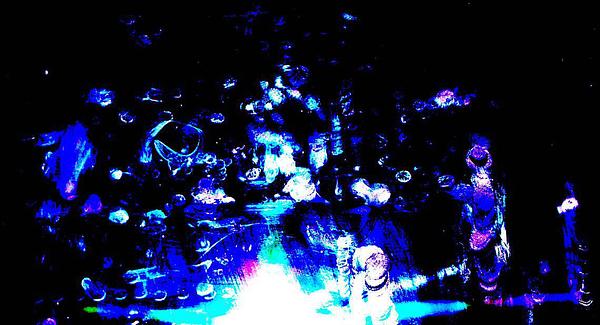Expérience de l’écriture : doit-on exalter la différence d’approche entre expressions prosaïque et poétique ?
Publié par Xavier Hiron, le 28 août 2022 2.6k
Illustration d'en-tête : Tête d'homme - détail d'une gouache sur carton par l'auteur (2005), fichier retouché numériquement (2017).
par Xavier Hiron
Le monde social changeant en permanence de dimension et de repères, ses modèles sont toujours en train d’évoluer. Dès 2007, je me suis posé une question étrange, dont la réponse ne va pas de soi. Est-il envisageable, me suis demandé, d’associer deux modes d’expression formelle aussi différents que la prose et la poésie ? Pour pouvoir y répondre, je me suis essayé à la rédaction d’un roman (Retour vers Cliff End, non publié) alternant volontairement des sections de prose et des poèmes. Tout en revendiquant son aspect novateur, par les retours privés que j’en ai reçus, j’ai été obligé de constater les écarts d’approche que ces deux formules d’expression génèrent : écart que j’ai tenté d’analyser comme suit.
Commençons par établir un premier point : le livre en question, qui relate le retour d’un soliste talentueux dans le village anglais qui l’a vu naître, constitue en premier lieu, dans sa structure même, une sorte d’antiroman policier. Il en a l’apparence, en usant préférentiellement de ses ressorts, de manière à créer une ambiance psychologique de réflexion et d’attente ; mais cette première définition est incomplète et l’entreprise qu’il veut mener à bien ne doit pas s’arrêter là. C’est alors qu’intervient un deuxième niveau rédactionnel : celui de la forme.
Il faut d’abord partir du principe que tout, dans mon entreprise, procède d’une volonté de créer un microcosme cohérent. Une réduction de l’univers présentée sous une forme épurée et parfaite : comme dans le cadre foisonnant d’une miniature persane… Loin de se placer sous l’angle de l’ornementation, mon ambition secrète était de créer une forme littéraire nouvelle et originale. Une forme adaptée à la teneur résolument marginale de mon discours.
En effet, la lecture d’un poème obéit à des règles différentes de celles de la prose. Il y a, tout d’abord, une volonté de concision là où la prose présente la volonté de dilution. Par ailleurs, il faut lire un poème lentement et si possible à haute voix ; car avec lui, on entre dans le domaine de la déclamation. Un poème semble clos sur lui-même ; devant contenir en lui-même l’essentiel nécessaire à son entendement ; mais n’exclut pas, dans le même temps, d’ouvrir des perspectives à clés multiples. Il fait donc appel à la participation active du lecteur, là où le discursif apparaît comme une prise en charge « clés en main », qui n’admet que très peu de moments de rêveries ou de déviation. Ces deux langages n’agissent donc pas du tout sur le même mode ; ils ne font, en effet, pas appel au même fonctionnement, intellectuellement parlant. Alors, pourquoi avoir tenté d’allier les deux ?
Justement, pour tenter de tirer un plus grand profit de cette différence. Leur juxtaposition est censée introduire une saine compétition entre ces deux modes de fonctionnement. Mais pour tenter de rendre sensible cette distinction, il convient de l’étayer à l’aide d’exemples opposés. Dans un premier registre, qui est celui de la poésie, je peux expliquer pourquoi, par exemple, j’ai personnellement pris l’habitude de positionner le titre de mes poèmes à la fin, et non pas, comme il est coutume de le faire, à leur début. Plusieurs raisons à cela. La première pourrait être exprimée comme une analogie de la signature du peintre en bas de sa toile. « Géographiquement » parlant, cela fonctionne sans coup férir. Mais ce n’est pas l’unique raison.
La raison plus profonde est que, si le lecteur se prend au jeu de ne découvrir le titre qu’a posteriori, il n’en concevra le sujet global qu’à la fin d’une première lecture dite de déchiffrage ; ce qui est de nature à l’interpeller. D’où le sentiment qui lui naîtra que le sujet, dans son esprit, n’en était qu’à l’état d’ébauche, ou de simple proposition, durant cette première lecture de « découverte ». Ce n’est qu’après une deuxième lecture attentive du poème, en pleine possession de tous ses éléments constitutifs, qu’il sera à même d’apprécier la valeur surnuméraire de l’aspect formel du poème, lequel transcende son sens général. Il lui faut donc consacrer un temps dilaté de lecture et de concentration intellectuelle adapté à ce mode particulier d’expression de la pensée. Et ce d’autant plus que tout n’est jamais explicitement exprimé dans un poème, mais laisse au contraire une place réservée pour la perception singulière qu’en retirera personnellement chaque lecteur. Si, en plus de cela, celui-ci se laisse imprégner des échos intérieurs dont le texte est porteur, le pari est déjà gagné…
À l’inverse de ce modèle contenu dans le poème, la prose, quant à elle, semble n’être qu’un mode de mise en scène d’une tension qui ira croissante jusqu’à son moment ultime, où la surprise d’un élément non maîtrisé (mais paradoxalement attendu) par le lecteur en viendra immanquablement à le subjuguer. Le discours prosaïque – que l’on peut d’ailleurs faire durer plus qu’il n’est de raison - commande donc la passivité du lecteur, d’une part ; et, de fait, ce mode d’expression finit par n’être plus qu’un artifice dont la vigilance de celui à qui il s’adresse n’est plus toujours apte, à la longue, à en saisir la grossièreté. C’est à ce niveau-là que, me semble-t-il, nous entrons de plain-pied dans la littérature dite commerciale.
Il est possible d’ajouter qu’il faudrait qu’on en vienne à considérer que toute démarche poétique contient une dose plus ou moins importante de symbolisme : à l’instar ce mouvement artistique qui, à la suite des correspondances baudelairiennes, a fini par décréter que les forces attractives qui relient entre elles les images (ou symboles) contenues dans une œuvre sont plus puissantes que celles qui la maintiennent artificiellement en connexion avec la réalité.
Ce qui est intéressant de noter avec l’insertion de parenthèses poétiques est le fait qu’elles deviennent sources de questionnements, d’interrogations, comme des supports supplémentaires qui aident à débrider l’imagination du lecteur. Et, au-delà d’elles-mêmes, elles deviennent susceptibles de provoquer des rapprochements, des visions, des images qui se répondent en écho, par-delà les chapitres et avec les chapitres eux-mêmes. Là se situe leur fonction primaire, qui est celle de la poésie en général ; on verra que cela n’empêche pas, bien au contraire, qu’elles puissent apporter un surplus de sens.
* * *
Un autre moyen d’exprimer ce qui précède serait de se poser la question : comment peut-on imaginer bâtir une pensée élaborée avec seulement 1500 ou même 2000 mots en moyenne dans son vocabulaire ? À contre-courant de la littérature de Marcel Proust, qui réalisa l’ampleur de la pensée diluée dans une phrase démesurément longue, à la fois souple et charpentée, laquelle nous suggère que le temps de l’écriture implique celui de la lecture, nous nous voyons, de nos jours, opposer la tyrannie de la phrase courte, que ni la pratique intensive du texto ou celle du SMS ne sont près d’améliorer. N’oublions pas cependant que derrière chaque mot ne vibre pas seulement un son, mais que se profile toujours un univers entier de significations possibles. Les milliers d’emplois teintés de nuances d’un même vocable sont là pour le prouver.
C’est la raison pour laquelle il serait désolant de ne s’arrêter qu’à la seule littérature factuelle ; et c’est aussi pourquoi un roman qui revendique une forte teneur psychologique se base avant tout sur la primauté des parcours intérieurs (seul véritable sujet de ces œuvres), y compris et surtout celui suscité dans l’esprit du lecteur. Car il s’agit avant tout d’établir une richesse, et non pas de nourrir un commerce. À ce compte-là, je pense n’être pas loin de la réalité lorsque j’imagine que des auteurs tels que Sartre et Camus, qui n’ont, somme toute, que 50 et 70 ans d’âge (et encore, la seconde disparition était prématurée), auraient aujourd’hui toutes les peines du monde à se faire éditer. Certes, d’aucuns pourraient arguer qu’ils sont, de nos jours, « passés de mode ». Et pourtant rien, dans leur œuvre, ne fait la moindre concession à l’air du temps. Tout au plus doit-on constater que leur engagement personnel, au cœur de leur époque, n’a fait que renforcer auprès de leurs lectorats leur caractère d’authenticité. Doit-on se suffire de tels signes des temps ?
En conséquence de quoi je prétends aussi que la crise actuelle que traverse (apparemment) l’édition est due en grande partie à la non prise de risques des éditeurs eux-mêmes. Je voudrais illustrer cette dernière constatation à l’aide de quelques exemples précis.
La difficulté rencontrée, dès avant 1913, par Marcel Proust lui-même pour se faire éditer est de notoriété publique. « Je veux bien qu’on m’explique l’intérêt qu’il peut y avoir à décrire ce que ressent un homme alité pendant plus de trente pages » se serait justifiée sa première lectrice chez Gallimard. On connaît le retentissement énorme que À la recherche temps perdu a eu, par la suite, même si, comme je viens de l’expliquer, cette focalisation s’est désormais largement estompée. J’en retiens malgré tout cette idée que ce qui est par nature « hors les normes » a toutes les chances, dans notre société soit disant permissive, d’être mal perçu.
Un ami nommé Jacques Prunaire, que j’ai perdu de vue depuis de nombreuses années, n’ayant jamais eu le sou mais éditeur lui-même à ses heures perdues (notamment des cours de Merleau-Ponty donnés à la Sorbonne ou de la correspondance du Docteur Gacher avec Paul Cézanne) m’avait confié un jour qu’il relisait avec délectation, chaque été, le livre fondateur de l’œuvre de William Faulkner, Satoris, sans jamais réussir à comprendre les fondements de la violence sociale dont il est porteur. Ce qui tendrait à prouver que la fascination n’a pas toujours besoin d’explication concrète.
André Malraux a longtemps pressé Gaston Gallimard de publier Louis-Ferdinand Céline, sans succès. Un jour, excédé par ses demandes à répétition, le père fondateur des éditions du même nom lui aurait répondu : « Mais ce n’est qu’un pauvre type ! » Et Malraux de lui rétorquer : « Oui, mais c’est un grand écrivain. » Je n’éprouve, pour ma part, aucune sympathie particulière pour le personnage dont il est question, mais son retentissement littéraire, dû à son sens entier de l’écriture et à la novation qu’il a introduite au niveau de la forme parlée immédiate (« quel pamphlétaire ! » a-t-on pu dire de lui) prouve que les succès commerciaux les plus durables sont souvent les plus inattendus.
Objectivement, qui aurait pu parier sur le succès du Petit Prince, même si l’on est forcé de louer la précision et la concision de l’écriture de son auteur ? Le sujet est ardu, le traitement elliptique, la forme philosophique novatrice et les finalités énigmatiques… Il contient, de plus, une forte teneur poétique, y compris dans les dessins mal ficelés que nous livre laborieusement son auteur… Et pourtant, la magie opère ! J’évacuerai ici comme un mauvais débat la question que pourrait soulever l’édition originale américaine de ce chef-d’œuvre, dès avant la fin de la guerre durant laquelle Saint-Exupéry perdit finalement la vie… De quelle alchimie procède ce mystère ?
Toutes ces situations nous amènent à nous poser la question suivante : qu’est-ce qu’un artiste ? Pour y répondre, il nous faut replonger aux fondements de ce terme. C’est Dante Alighieri qui, dans la Divine Comédie, usa pour la première fois de ce mot, pris dans l’assertion moderne que nous lui connaissons aujourd’hui : qui est que l’artiste est celui qui apporte un surplus de perception et de ressenti humain dans la production matérielle qu’il livre au public. Il l’appliquera par la suite à son ami Giotto di Bondone, dont les fresques sont un modèle d’intériorité et d’élévation spirituelle. Cette naissance d’un concept est à mettre en parallèle avec la constatation que l’époque de la toute première Renaissance a consacré, en son temps, l’éclosion d’une suprématie de la bourgeoise commerçante et de la société des villes. On en mesure la postérité actuelle, six siècles plus tard… Malheureusement, ce n’est plus celle de l’humanisme désintéressé, mais bien celle de l’asservissement de la forme au goût du plus grand nombre. Le commerce a repris ici tous ses droits, qui, à bien des égards, consistent en l’antithèse de la définition originelle du mot artiste. En regard de quoi, les lois actuelles de la commercialisation de l’art, avec sa tyrannie des modèles – comme par hasard, tous d’essence anglo-saxonne - auxquels tout produit se doit de ressembler, représentent une régression.
Dans ce contexte, quid, par exemple, des motivations altruistes des mécènes humanistes ? Tout comme pour chaque histoire qui ne serait écrite que sous l’unique impulsion d’un modèle à respecter court le risque de devenir structurellement interchangeable avec toutes les autres... Je suis donc forcé d’en revenir ici à la notion de poésie. Nous avons déjà établi, pour commencer, que le temps de la lecture poétique représente un temps différent de la lecture prosaïque. Temps qui, malheureusement, est de plus en plus souvent en décalage avec notre société centrée sur la vitesse. Pour conforter cette idée, signalons aussi que ce n’est pas pour rien si chaque sagesse extrême-orientale s’est accompagnée d’une forme particulière de poésie (poésie zen, poésie bouddhiste, poésie taoïste…), elles qui prônent la recherche d’une perception individuelle de la plénitude du temps.
Considérons aussi que le temps de la poésie est par nature fractionné, sinueux, introspectif, donc incitatif à un retour sur soi hautement participatif, puisqu’il sollicite l’intervention « investie », ou passionnée, du lecteur. En effet, un poème n’est jamais totalement fermé sur lui-même ni n’appelle aucune interprétation définitive. Le poème, avec sa force d’abstraction, incite au contraire le lecteur à une plongée dans les limbes : par le sujet choisi, d’abord ; par son traitement spécifique, ensuite ; par sa forme singulière, enfin.
* * *
Pour résumer les critiques fondamentales que met en exergue le débat suscité par ce genre d’expérience romanesque, il existe deux éléments principaux à prendre en considération :
- 1/ loin de vouloir ériger une nouvelle Défense et l’illustration de la langue française, je me contente d’énoncer un principe qui me paraît fondé : à savoir que la langue définit la pensée. L’une et l’autre, d’ailleurs, ne constituent-elles pas une donnée à sauvegarder en priorité, dans un monde qui semble vouloir les bafouer de toute part ?
- 2/ il me paraît tout autant indispensable de tenter une réévaluation actuelle des critères de jugement d’une œuvre d’art. Ce deuxième point doit d’ailleurs être mis explicitement en parallèle avec le débat récent qu’a initié, dans le domaine économique, la notion de décroissance. En effet, si une décélération doit être amorcée dans un domaine quel qu’il soit, n’est-il pas légitime d’espérer qu’un progrès puisse être attendu, en compensation, dans un domaine connexe ? C’est exactement ce type de fonctionnement que ma tentative suggère. Je ne prétends pas qu’il suffise de s’y essayer pour parvenir du premier coup à une réussite complète. Je dis seulement que cette aventure humaine vaut la peine d’être menée. Et, par la même, d’être écoutée…
Cette double démarche est d’autant plus volontaire que j’ai pleinement conscience que la poésie, que je pratique depuis quarante ans en toute connaissance de cause, est, littérairement parlant, un mode d’expression du passé et qu’il ne fédère plus aucune audience médiatique autre que marginale. Socialement parlant, la poésie s’est lentement diluée dans la chanson : mais cette dernière ne procède pas non plus de la même façon (à quelques rares exceptions près), n’impliquant pas les mêmes ressorts et n’atteignant pas aux mêmes impacts. La poésie, prise en tant que langage spécifique et autonome, semble donc devoir être à protéger et, si possible, à revaloriser. Il s’agissait d’ailleurs d’un des buts seconds de ma tentative et, certainement aussi, cela représente, du même coup, l’un de ses écueils majeurs : car qui aura la patience de réapprendre à lire et à comprendre la poésie ? Et puis, une telle démarche se développe intentionnellement à contre-courant du sens social général ; elle constitue une de ces prises de risque qui ne va pas, ordinairement, sans que fusent de toutes parts les critiques… La boucle est ainsi bouclée.
* * *
Note :
Pour reprendre contact avec les articles littéraires de Xavier Hiron, cliquez ici
(Le 15-09-2023 a été ajouté le roman complet Retour vers Cliff End en 3 fichiers, contenant en annexe une Postface analytique)