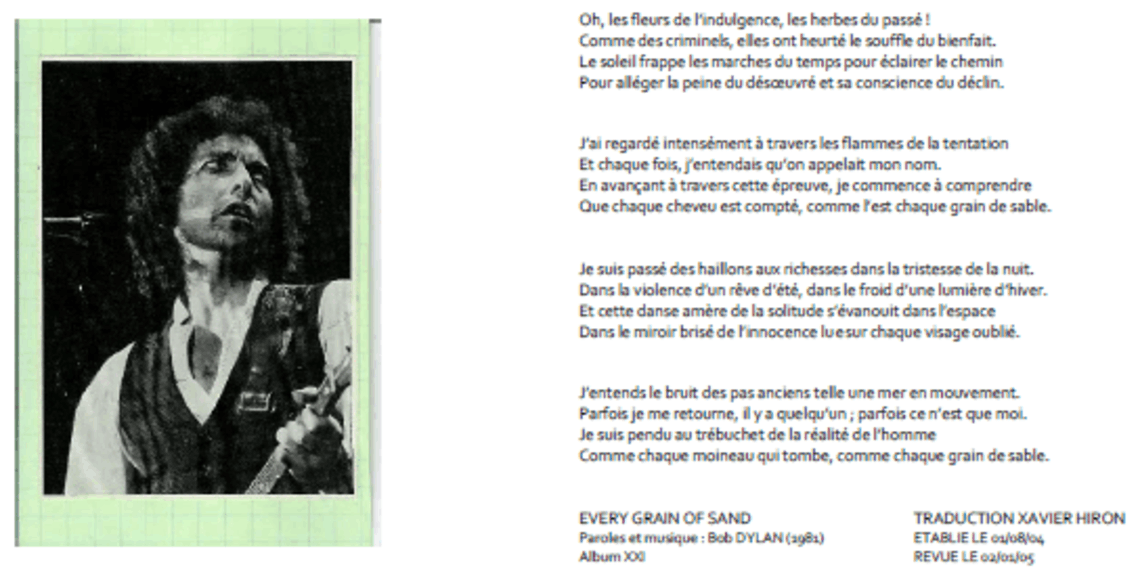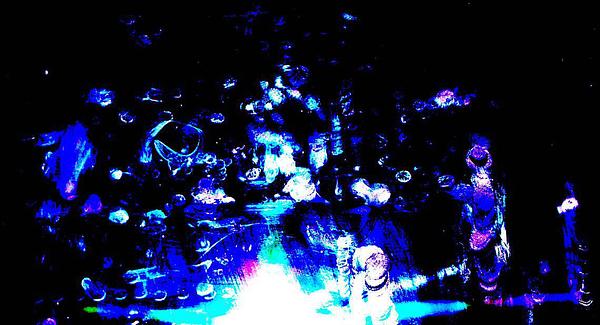POUR UNE ESQUISSE DE BOB DYLAN : spécificité littéraire de l’œuvre chantée 1/2
Publié par Xavier Hiron, le 13 juin 2021 1.8k
Image d'en-tête : Détail d'une carte d’auto-diffusion datant de l'année 2005, © Xavier Hiron
Ce texte présente, au-delà des traductions en elles-mêmes et de l’esprit avec lequel elles ont été entreprises (voir à ce sujet la Note sur l’esprit d’une traduction), la spécificité littéraire de ce que l’on peut bien appeler, au final, une œuvre. En effet, on peut s’étonner que celle qui a été conçue dans le contexte et pour une finalité essentiellement musicale (je veux parler de ce qui a accompagné l’essor de son industrie) ait reçu un tel accueil, au point de se voir attribuer, en 2016, la plus prestigieuse récompense en la matière, le prix Nobel de littérature. Ce texte écrit en 2012 tentait par anticipation d’en faire ressortir les éléments caractéristiques.
L’ambiguïté de Bob Dylan, ou l’être convoqué à l’assemblée des dieux
ENTRE CONTRADICTION ET PARADOXE
Dans le film No direction home - document magistral de justesse et d’intelligence -, que Martin Scorsese consacre au monstre sacré de la musique populaire américaine de la seconde moitié du XXe siècle, Bob Dylan lui-même n’hésite pas à évoquer le terme de « méprise » pour parler de son fulgurant succès générationnel. Et pourtant, qui aura plus que lui cherché à susciter cette formidable résonance sociétale ? Qui aura plus que lui créé les conditions favorables pour que naisse cet écho inégalé ; écho dont il a cependant si souvent cherché à nier l’ampleur, a posteriori ? Mais il est vrai que certaines vérités ont besoin d’ambiguïté pour pouvoir s’épanouir. Et à travers les questions évoquées ci-dessus se situe indubitablement l’ambiguïté essentielle que véhicule l’œuvre de Bob Dylan. C’est donc celles-ci qu’il va nous falloir décrypter en priorité si l’on souhaite parvenir à décoder le fonctionnement de l’individu Dylan. C’est ce mouvement à la fois confus et subjuguant qu’il va nous falloir décomposer si l’on souhaite comprendre et apprécier à sa juste valeur l’apport de la démarche de cet artiste hors normes et de la véritable révolution qu’il aura suscitée. Et pourtant : que de matériaux hétéroclites, événements contradictoires, d’allers et retours incessants - du moins en apparence -. Pour cette raison, il va nous falloir opérer un retour en arrière dans l’histoire de l’art de notre époque.
C’est Baudelaire lui-même qui, le premier, en tant que fondateur reconnu de la modernité dans l’art, a revendiqué le droit à la contradiction interne de l’œuvre d’art. À dire vrai, il ne s’agit pas uniquement d’évoquer par là une conséquence qui pourrait paraître suspecte, ou que l’on pourrait juger nuisible après coup, du fait même d’écrire, ou qui ressortirait de l’examen du produit de l’écriture de tout artiste digne de ce nom, mais plutôt de constater - et tant d’auteurs se sont emparés de ce simple argument pour en porter, après lui, les effets jusqu’à leur paroxysme - que c’est bien souvent les contradictions mêmes que recèlent en elles les œuvres d’art qui créent leur tension interne, leur dynamisme, leur foisonnement, voire leur identité.
Il y aurait plusieurs moyens pour parvenir à ce but. En premier lieu, il y a les procédés qui sont feints - et donc forcement vaniteux dans leurs effets -. Et toutes les productions qui sont issues de cette façon de concevoir l’œuvre d’art portent l’apparence de l’artificiel et du surfait (on pourrait évoquer ici la notion de dandysme que l’on a tant reproché à ce même Baudelaire, ainsi que celle plus récente de « kitch », qui correspond particulièrement bien à l’époque que nous considérons avec Bob Dylan). Mais ne nous y trompons pas : si ces œuvres ne résistent pas aux modes, c'est-à-dire à l’analyse du temps, elles n’en constituent pas moins un héritage tangible de cette manière de concevoir et d’appréhender la création contemporaine et que nous aura légué dans l’art la notion même de modernité. Et à coté de ces premiers procédés, innombrables autant que de peu d’intérêt, il y a ceux qui, fort heureusement, conservent en eux une forte prééminence de la part d’authenticité de l’individu.
Mais quelle serait, alors, cette authenticité ? Comment se pourrait-elle caractériser, et donc discerner ? Pour parler de Dylan, on pourrait avancer comme postulat de départ que la contradiction interne de son œuvre serait qu’elle se situe à la croisée des chemins entre les deux voies que l’on vient d’évoquer : l’une artificielle, et l’autre authentique. Mais ceci aurait pour effet surprenant de la rendre d’emblée plus magistrale encore. Car le paradoxe initial de l’œuvre de Bob Dylan serait de venir confirmer de facto que certaines ambiguïtés tiennent lieu, à elles seules, de vérité.
Car la démarche artistique de Bob Dylan s’apparente en tous points à la démarche picturale d’un Pablo Picasso. Elle serait celle d’un grand « bouleversificateur » s’il en est, et qui renouvellerait le langage - qu’il soit pictural, musical ou de toute autre nature - en continu, à partir de la dé-composition (pour ne pas dire du dépeçage en profondeur, et vécu comme une nécessité durable et absolue) d’une plus haute tradition classique. Oui, Bob Dylan est un bulldozer de la même espèce que Pablo Picasso, dont le credo avoué était : « je ne cherche pas, je trouve. » Un ovni du même type, au sens propre comme au sens littéral, qui creuse, arrache, chamboule, pioche, démembre, pour ainsi mieux ré-assembler, re-fondre, re-créer et, finalement - et c’est ce qui a une importance primordiale sur tout le reste qui précède -, pour mieux restituer.
LE BANQUET DES CARNIVORES [1]
Car cette tentative permanente et vécue dans la continuité - comme érigée en méthode - ne sert qu’un seul but, unique et précis : créer en permanence de l’émotion. Vivifier la spontanéité. Et par là même, trouver cette authenticité incessante dont il était question plus haut. Ainsi, la boucle du paradoxe serait-elle bouclée in vivo, et l’on toucherait par là, véritablement, à la question fondamentale de la justification d’une démarche artistique quelle qu’elle soit. Bob Dylan - et cela ne constitue pas le moindre de ses succès - nous contraindrait donc à repenser en permanence la question de l’œuvre d’art.
Ce qui se profile ou se cache - c’est selon - derrière cette notion de la restitution artistique et dans celle de l’efficacité dans la création de l’artiste, c’est l’enjeu même de la création. Le mobile en tant que tel de l’acte de créer. Au-delà même du simple fait du vouloir exister en tant qu’artiste - et qui se suffirait en soi en tant qu’argument artistique, en tant que justificatif de toute condition de poète, d’écrivain, de musicien, de peintre, mais tout aussi bien de celles de jardinier, de couvreur, de maçon, d’ingénieur ou de savant, etc. -, oui, ce qu’il y aurait à prouver par une telle démarche, dans le positionnement intellectuel qu’impose une telle nature, ce serait que la création ne peut en aucun cas se concevoir comme un concept fumeux et qui resterait en perpétuel devenir, mais que cette dernière trouve bel et bien sa justification d’exister dans la matérialisation, aussi fréquente que spontanée, aussi spontanée que - parfois - parfaite, d’un simple désir d’exister ou d’une moindre envie de naître au monde. En cela, l’identification souvent citée de Bob Dylan avec Arthur Rimbaud prendrait ici tout son sens.
Mais que cacherait, plus profondément enfouie en l’être, cette volonté continuellement réaffirmée par un Bob Dylan de la transcription du réel dans l’art ? Car à tous les coup, cette soif, cette faim, cette débauche d’énergie qu’il concède pour assouvir ce besoin inextinguible de la transcription dans un autre réel du réel lui-même devient, à travers lui, une véritable fin en soi. À convoquer les dieux en parlant de Dylan, il devient impossible d’omettre le fait que sa surabondance d’efforts et sa débauche d’énergie dans le domaine de la création (pensez donc : pas moins de 35 albums studios, paroles et musique, en près de 50 ans de carrière, sans compter ses 9 albums live, tandis qu’il continue, à 70 ans passés, à enchaîner les prestations publiques et les albums épisodiques), ainsi que sa frénésie de représentations auprès du public, font immanquablement pendant à l’œuvre colossale d’un Victor Hugo par exemple, dont on a avancé qu’il possédait une véritable science pour la récupération du matériau littéraire [2].
Le désir comme moteur essentiel de la création étant ainsi établi de lui-même - encore qu’il ne faille pas négliger de citer les recherches récentes sur le fonctionnement du cerveau et l’apport des amines spécifiques (ou neurotransmetteurs), telles que l’adrénaline et la dopamine, mais en renvoyant immédiatement au débat fondamental sur les causes et les conséquences, lequel débat, bien évidemment, ne saurait recevoir ici de réponse tranchée -, il resterait ensuite à établir la question des moyens. Car saurait-on démêler aussi facilement, justement, ce qui est cause de ce qui est conséquence en matière de création artistique ?
Ce qui est en jeu, semble-t-il, dans la démarche d’un Bob Dylan, est la question primordiale des intentions du poète. Chez Dylan, en effet, toute création semble venir d’un seul jet, d’un seul tenant, d’une seule effusion, sans préméditation excessive, sans surcharge de justification préalable - puisque tout semble aller de lui-même et s’autojustifier en permanence par le simple fait d’être ce qu’il est -. Tout vient au monde des émotions sensibles d’un seul bloc, comme posé avec le rocher. Aussi, qu’est-ce qui a bien pu préexister à quoi : le sujet ou la forme ? Impossible de le démêler, même a posteriori. Tout est, dans l’univers de son art, sans aucune autre éventualité que celle d’être au monde - que celle d’être dans son propre monde -. Sans aucune autre justesse que de vivre sa propre existence dans un univers autonome de parole et de musique.
LE RYTHME EST LA DANSE DES DIEUX
En réalité, tout, chez Dylan, s’élabore - et c’est le cas d’ailleurs chez tous les artistes titanesques - dans le jaillissement de la simultanéité. Rien ne compte que ce qui est d’emblée advenu. Et seul un regard de rapace aigu est capable de supporter cela. Un carnassier de grande envergure, pourrait-on dire. Ce n’est pas pour rien si l’on a souvent reproché à Bob Dylan d’avoir autant emprunté. Mais la vraie question sur ces emprunts resterait celle-ci : quelles intentions intrinsèques ont servi ces emprunts (je préférerais, pour ma part et dans la majorité des cas, parler d’assimilation) ? Pour quelle transcendance ont-ils été commis ? Pour quelles visions - et l’on en reviendra toujours, avec Dylan, à la même problématique - ainsi restituées ?
D’Albert Einstein - encore un autre géant - on a pu dire qu’il avait su convoquer une approche poétique de la science : et pour quelle avancée ! Pour quelle incommensurable vision offerte au monde, elle qui aura tant bouleversé (au sens propre comme au sens figuré) notre appréhension de l’univers ! La compréhension du monde par l’artiste vrai est à cette image : inégalable, inatteignable par autrui et irrémédiablement instantanée. C’est pourquoi l’artiste n’apporte jamais de réponse. Ce que l’artiste apporte, c’est la pertinence et la permanence du questionnement de l’homme. Et ce que touche l’artiste par le questionnement, c’est la notion de l’universel en soi. C’est la conceptualisation du réel alors même que le réel reste une matière en devenir.
Aussi pourrait-on admettre que le réel est, dans bien des cas, fait réel par la vision même de l’artiste - tout comme le réel est fait réel par la vision du savant, mais à une autre échelle et pour d’autres visées -, puisque rien n’existe réellement au monde sensible des idées avant qu’il n’ait été expressément formulé. Alors même que la pertinence du réel est posée, alors même que s’ébauche déjà les possibilités de réponses concrètes à offrir au réel ainsi posé, l’artiste est déjà plus loin, l’artiste est déjà ailleurs. Être insaisissable s’il en est : c’est en cela que la vision de l’artiste vrai reste toujours première. Car il est toujours en amont, toujours devant les choses, et non soumis à elles. Mais ce qu’il faut bien comprendre en même temps, et que nous apprend Bob Dylan, c’est que cette faculté d’anticipation se nourrit, chez l’artiste, d’un contenu préalable, d’un véritable « combustible » préexistant, et c’est en cela que le travail d’appropriation est inhérent à la démarche de l’artiste. Tant est si bien que ce décalage permanent entre tradition et restitution finit invariablement par mettre l’artiste en porte-à-faux et à le soumettre immanquablement au feu continuel des critiques. Ainsi en est-il, au passage, de l’un des autres paradoxes de l’artiste : être à la fois adulé et critiqué en permanence pour ce qu’il est ou ce que l’on croit reconnaître qu’il représente.
C’est pourquoi le propos artistique de Dylan nous semble parfois se résumer à cette oscillation constante entre exploiter le creuset ou la racine de la tradition (celle qu’il s’est cherchée, et donc celle qu’il s’invente au fur et à mesure qu’il progresse dans son art) et sa réinvention en continu dans une perfection autonome et quasi instantanée. En cela, l’ambivalence de Dylan pourrait se traduire en ces termes : la tradition nourrissant la modernité dans un renouvellement rythmique et textuel perpétuel.
Car Dylan, en bon créateur qu’il est, ne se contente pas de faucher allègrement parmi les prairies de la tradition musicale. Mais il prend n’importe quel prétexte de la vie même qui l’entoure comme matière à composer : par le texte, il aborde aussi bien le fait social que la ségrégation rampante, l’hypocrisie politique naissante que la racine terrienne dont celle-ci se nourrit, l’amour bafoué qui génère le mal d’être sur terre que l’errance existentielle comme condition humaine… Ce faisant, tout ce qui lui passe sous la main ou par l’esprit – ou, pour être plus exact encore, sous sa plume -, devient un matériau à façonner. C’est un gigantesque domino intellectuel que le poète s’invente en permanence à lui-même et qu’il s’approprie pour en devenir le maître, le manipulateur - au sens matériel du terme, tel un potier pétrissant la pâte -, le thaumaturge, en même temps qu’il s’instaure démiurge d’une mythologie mi-sociale et mi-personnelle en mouvement continuel.
Parallèlement à cet élan, (c’est-à-dire - et j’insiste sur ce point - simultanément à cet élan), Dylan se fait l’inventeur magistral de la fusion musicale du folklore populaire américain (le folk) et du mouvement rock-and-roll encore naissant, avatar des racines blues noires américaines de la rythmique nègre réappropriée par les blancs, dans un conglomérat bouillonnant d’œuvres toutes plus inspirées les unes que les autres. Et c’est cela seul qui compte, désormais, au yeux de l’histoire des hommes, puisque c’est cela qui reste et restera définitivement de l’artiste Bob Dylan pour les temps à venir - lui qui demeure encore, à l’heure actuelle, le compositeur de chansons le plus repris au monde -. L’essence même de son art : restituer ses offrandes au monde sensible, à la sensibilité de l’esprit, à l’émotion de l’âme intuitive et cognitive à la fois, en privilégiant le bouillonnement comme une marque vitale due au genre humain (et dont ce dernier ne ressortira - il le sait au fond de lui-même - ni vivant ni indemne).
_ _ _
Notes :
[1] on me pardonnera cette image toute littéraire qui ne s’attache qu’à caractériser l’état d’esprit de l’artiste créateur, sachant que l’homme Dylan s’est depuis longtemps converti exclusivement à la cuisine végétarienne.
[2] Dylan, pour sa part, ne se contente pas de se « produire » sur scène, mais il émaille chacune de ses prestations publiques de re-créations musicales de ses propres chansons, comme autant de productions satellitaires de ses œuvres initiales.
(La suite et fin de ce texte est à venir en partie 2).