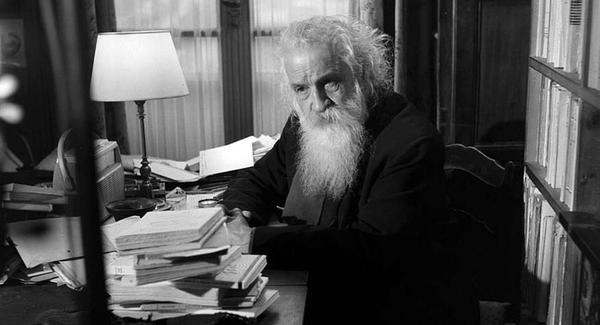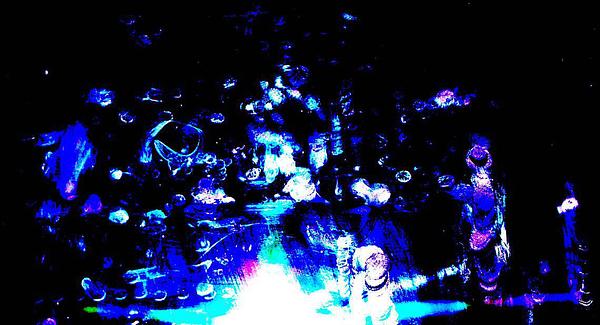Observe-t-on une crise de la morale capitaliste : Synthèse et conclusion
Publié par Xavier Hiron, le 18 octobre 2021 1.4k
Sur quoi pourrait déboucher le mini essai synthétisé dans les quatre parties exposées dans mes articles précédents, additionnées de diverses incursions vers le domaine de l'art ? À quoi, en effet, pourrait-il servir, s’il n’est pas porteur de possibles remèdes à apporter à une situation qui a été décrite comme étant non complètement conforme aux attentes humaines générales ?
En premier lieu, il est toujours bon de comprendre le fondement des rouages du monde dans lequel nous vivons, fussent-ils souterrains, dans le but de se positionner soi-même plus efficacement, étant donné qu’il n’existe pas de réponse univoque à la question de savoir comment s’insérer, socialement parlant. Au-delà du positionnement des individus, la saveur qu'en dégagera l'artiste sera celle d'une vision du monde issue d'une palette globale et cohérente.
Bien évidemment, il ne s’agissait pas non plus, à travers cette démonstration esquissée, de tenter de s’ériger en vain moralisateur simpliste en cherchant à désigner les bons ou mauvais comportements. Ce qui a été montré sont les tenants et aboutissants d’un comportement général qui, parfois, n’exprime pas de frontière précise. En cela, d’ailleurs, réside toute son ambiguïté. Mais il montre aussi qu’à l’échelle de l’histoire, un processus s’est mis en marche, dont il est bien difficile de savoir ou commence et où se termine sa part potentiellement condamnable. L’œil de l’historien n’a fait qu’examiner les faits. Mais en tant que citoyen, la question se pose de savoir s’il est possible d’œuvrer pour qu’un système de nature diffuse, dans l’entièreté de ses composantes, redevienne spontanément vertueux ?
Premier constat : tout ceci se développe au sein de la société à partir d’une multiplicité de paramètres contraires, de forces qui interagissent ensemble pour, au final, osciller sans cesse entre harmonisations ou oppositions temporaires. Leur maîtrise est donc difficilement atteignable sans outils adéquats - bien que les pouvoirs politiques aient justement pour enjeu latent de chercher à les canaliser -.
Deuxième constat : il ne convient pas non plus de chercher à entretenir les jugements de valeurs ambiants sur la question, mais plutôt de tenter de décrypter utilement des mécanismes qui sont à l’œuvre. Pour ce faire, il nous faut séparer ce qui est de l’ordre des contraintes techniques liées à la gestion des affaires économiques, domaine qui a tendance, on le voit au quotidien, à se complexifier à l’usage, de ce qui procèderait d’une légitimité de finalités à visées « humanistes »* (et donc porteuse de l'application d’une critique d’ordre plus systémique).
D’une part, ayons conscience que dans cette technicité même se cache l’un des paravents qui, parfois, évitent aux acteurs peu scrupuleux de se questionner sur le bien fondé social de telle ou telle action. Cela touche à la conscience individuelle sur laquelle le collectif n’a, finalement, que peu d’emprise, chacun de nous ayant en soi ses petits secrets à protéger. Surtout que, d’autre part et dans le même temps, l’économie doit bien continuer à répondre concrètement à certaines règles ou habitudes de fonctionnement, afin de soutenir son rôle sur le long terme. Tout ceci constitue la force du sillon social qui fait qu’une amélioration « naturelle » ne peut se concevoir que dans la durée… pour une issue forcément aléatoire !
Ce que l’on peut en déduire est qu’il n’y a pas de critique fondamentale possible du capitalisme dès lors qu’il s’agit d’exprimer que la gestion et la performance des outils de production doivent, dans les faits, être soutenues et assumées. Mais il y aurait bien, cependant, l’opportunité d’émettre une critique sociale du libéralisme dès lors qu’il s’agirait de constater que ce mode de gestion ne porte pas en soi ses propres critères limitatifs (pas plus que l’art, comme on a pu le voir par ailleurs, ne les porte non plus, formellement parlant) ; mais ces deux notions (économie et art) s’en remettent, bien au contraire, à une opposition frontale avec des forces de contraintes venues de l’extérieur (écologie, syndicalisme, morale religieuse ou environnementale, intérêts politiques ou philosophiques de tous ordres, divergences d’objectifs, notions esthétiques du bien et du beau, etc…) pour circonscrite leurs domaines d’action. C’est en cela que ce morceau d’essai n’en vient pas à la conclusion d’une immoralité libérale (qui elle-même serait différente d’une immoralité potentielle des individus, car nulle âme n’est sans défaut, comme nous invitait déjà à le penser Arthur Rimbaud), mais bien que cette attitude, si elle s’érige en pensée doctrinaire (ce qui est bien le cas, comme nous avons pu le démontrer), devient du même coup « a-morale », dans le sens qu’elle ne peut être porteuse ni intégrer en soi ses critères intrinsèques d'une définition morale. Et ce d’autant plus sûrement que cet état de fait fut consciemment décrypté et accepté en tant que tel par ses premiers théoriciens. Tout est donc ici question de culture, prise au sens large du terme, et d’état d’esprit comportemental…
Alors, quel genre de remède serait-il possible d’appliquer à une telle situation ? Si l’on veut espérer un jour pouvoir sortir de l’ornière, commençons tout d’abord par établir une simple constatation : le père de l’écrivain Honoré de Mirabeau eut un jour ce bon mot que nous rapporte le journaliste Jean-François Khan, dans son ouvrage sur Victor Hugo** : « C’est Dieu, disait-il, qui a fait les poètes et les artistes. Il fallait bien rendre le monde logeable. » Il est tout d’abord intéressant de considérer que c’est à un misanthrope accompli que l’on doit cette pensée altruiste, laquelle possède le mérite, dans un premier temps, d’éclairer sur la nature même de cette misanthropie, ressortant d’un acte d’amour social déçu. Mais il faut aussi remarquer que « logeable » signifie « vivable, habitable ». Et qu’en effet, pourrions-nous imaginer sans effroi ce que serait un monde sans cette échappatoire salubre de l’espérance d’un monde sereinement « logeable » ? Ni sans aucune autre de ces aspirations profondes qui nous porteraient, d’un élan continu, vers la beauté idéale, sous la bannière de laquelle se range l’harmonie, au bénéfice de l’esprit de partage, dans la sage conduite de nos affaires humaines ? Toute notre problématique actuelle ne se résout-elle pas, finalement, à cette unique et saine constatation ?
Le seul moyen paisible étant, en la circonstance, d’en appeler à la conscience individuelle, avec une énergie inversement proportionnelle à celle déployée par Alexis de Tocqueville : car adopter une posture d’artiste n’est jamais neutre, socialement parlant. Pour le reste, face à de tels mécanismes ancestraux, seule la force de conviction intérieure des individus semble être à même de pouvoir provoquer cet embellissement inespéré du monde dont nous avons tous un absolu besoin…
NOTES :
* je mets ce terme entre guillemets parce qu’il ne me semble pas totalement adéquat ; et pourtant, aucun autre mot ne me vient spontanément à l’esprit pour désigner au plus près cette aspiration à une bienveillance collective universelle, clairement identifiée et partagée de tous.
** collection Pluriel, éditions Arthème fayard, 2018.
*** le a- privatif désigne ici le sens littéral « d’absence intrinsèque d'esprit moral » (la morale étant, par définition, une donnée collective – ou à destination du collectif -) ; précisons que le texte de mon essai d'origine (parties I à IV) a été écrit au moment où des soutiens de Nicolas Sarkozy ont voulu réhabiliter l'image publique d'Alexis de Tocqueville, tout en cherchant à éluder de son discours sa portée partisane.
(voir en colonne de gauche le PDF du texte intégral de cet essai en 2 parties - version revue en juillet 2025)